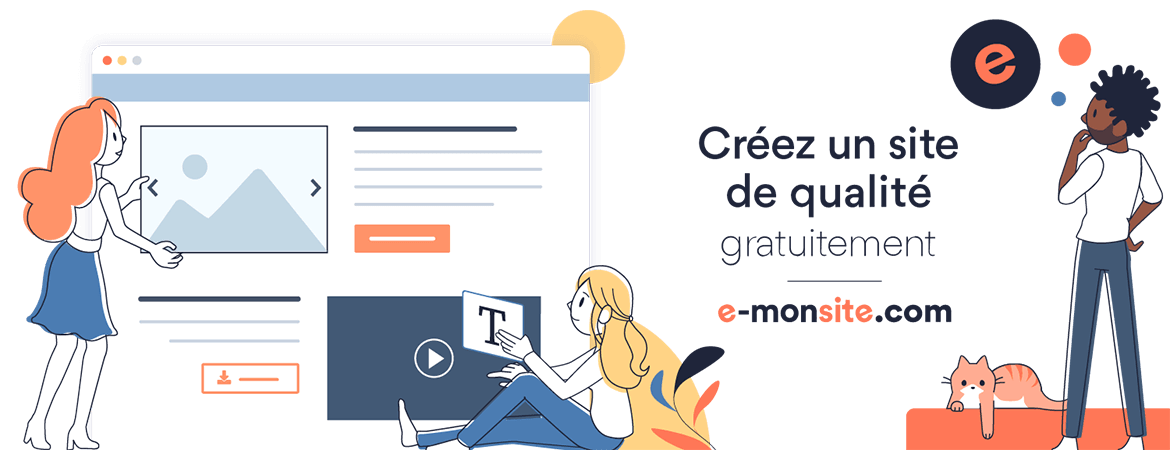- Accueil
- Blog
Blog
Platon : la rhétorique est un sport de combat
![]() Par
sgarniel
Le 03/03/2022
Par
sgarniel
Le 03/03/2022
GORGIAS. – « Et encore, si tu savais tout, Socrate, la vérité universelle, pour ainsi dire, des vertus efficaces [que la rhétorique] embrasse et qu’elle tient sous sa domination ! J’ai une preuve d’importance à te donner. Il m’est souvent arrivé d’accompagner personnellement mon frère ou d’autres médecins auprès d’un malade qui refusait soit de boire un remède, soit de s’offrir au bistouri ou au cautère du médecin. Or, quand le médecin n’arrivait pas à le persuader, c’est moi qui le faisais, sans autre technique que l’éloquence. Je pèse mes mots : dirige vers la cité que tu voudras les pas d’un orateur et d’un médecin, et supposons qu’il faille ouvrir une compétition par la force du verbe dans l’Assemblée ou dans toute autre réunion pour savoir lequel des deux sera choisi comme médecin, au grand jamais, je pèse mes mots, le médecin n’entrera seulement dans la course, et le choix se portera sur celui qui sait parler, pour peu qu’il le veuille. Qu’on le mette, s’il faut, en face de n’importe quel technicien pour une semblable compétition, il persuadera à l’Assemblée de le choisir, lui, l’homme de la rhétorique, plus sûrement que ne ferait un technicien pris dans n’importe quel secteur. Il n’y a pas de domaine où le verbe de l’orateur n’arrive à persuader plus sûrement que tout autre technicien pris dans n’importe quel secteur, devant la foule. Telle est la puissance, dans toute son étendue et toute sa pointe, qui est celle de notre métier. Il faut pourtant, Socrate, faire de la rhétorique l’usage qui est celui de toute autre compétition de combat. [...]
Un pouvoir qui peut s’attaquer à tout le monde, tel est l’apanage de l’orateur par son verbe, qu’il peut aussi bien employer à n’importe quel sujet, et il a de ce fait un impact considérable de persuasion auprès des foules, en somme sur le thème qu’il voudra. Néanmoins, cela ne l’autorise pas à ôter aux médecins leur réputation, du fait qu’il en a le pouvoir, aux médecins ou aux autres métiers. Il doit user de l’éloquence selon la justice, tout comme des arts de combat. »
Platon, Gorgias (IVème siècle av. JC)
Heidegger : l'homme est un être de parole
![]() Par
sgarniel
Le 03/03/2022
Par
sgarniel
Le 03/03/2022
« L’être humain parle. Nous parlons éveillés ; nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu’écouter ou lire ; nous parlons même si, n’écoutant plus vraiment, ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail, ou bien nous abandonnons à ne rien faire. Constamment nous parlons, d’une manière ou d’une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. Cela ne provient pas d’une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On dit que l’homme possède la parole par nature. L’enseignement traditionnel veut que l’homme soit, à la différence de la plante ou de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu’à côté d’autres facultés, l’homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c’est bien la parole qui rend l’homme capable d’être le vivant qu’il est en tant qu’homme. L’homme est homme en tant qu’il est celui qui parle. »
Martin Heidegger, Acheminement vers la parole (1959)
E. Morin. Science avec conscience
![]() Par
sgarniel
Le 25/11/2021
Par
sgarniel
Le 25/11/2021
"Depuis trois siècles, la connaissance scientifique ne fait que prouver ses vertus de vérification et de découverte par rapport à tous autres modes de connaissance. C'est la connaissance vivante qui mène la grande aventure de la découverte de l'univers, de la vie, de l'homme. Elle a apporté, et singulièrement dans ce siècle, un fabuleux progrès dans notre savoir. Nous savons aujourd'hui mesurer, peser, analyser le soleil, évaluer le nombre de particules constituant notre univers, déchiffrer le langage génétique qui informe et programme toute organisation vivante. Cette connaissance permet une précision extrême dans tous les domaines de l'action, jusque dans le guidage des vaisseaux spatiaux hors de l'orbite terrestre.
Corrélativement, il est évident que la connaissance scientifique a déterminé des progrès techniques inouïs, dont la domestication de l'énergie nucléaire et les débuts de l'ingénierie génétique. La science est donc élucidante (elle résout des énigmes, dissipe des mystères), enrichissante (elle permet de satisfaire des besoins sociaux et par là d'épanouir la civilisation) et, de fait, elle est justement conquérante, triomphante.
Et pourtant, cette science élucidante, enrichissante, conquérante, triomphante, nous pose de plus en plus de grave problèmes qui ont trait à la connaissance qu'elle produit, à l'action qu'elle détermine, à la société qu'elle transforme. Cette science libératrice apporte en même temps des possibilités terrifiantes d'asservissement. Cette connaissance vivante est celle qui a produit la menace d'anéantissement de l'humanité. Pour concevoir et comprendre ce problème, il faut en finir avec l'alternative stupide entre une « bonne » science, qui n'apporte que des bienfaits, et une « mauvaise » science, qui n'apporte que des méfaits. Il nous faut, au contraire, dès le départ, disposer d'une pensée capable de concevoir et de comprendre l'ambivalence, c'est-à-dire la complexité intrinsèque qui se trouve au coeur même de la science. [...]
Nous savons de plus en plus que le progrès scientifique produit autant de potentialités (1) asservissantes ou mortelles que de potentialités bénéfiques. Depuis le déjà très lointain Hiroshima, nous savons que l'énergie atomique signifie potentialité, elle comporte des dangers, non seulement biologiques, mais aussi ou surtout sociaux et politiques. Nous pressentons que l'ingénierie génétique peut autant industrialiser la vie que biologiser l'industrie. Nous devinons que l'élucidation des processus biochimiques du cerveau permettra des interventions sur notre affectivité, notre intelligence, notre esprit.
Plus encore : les pouvoirs créés par l'activité scientifique échappent totalement aux scientifiques eux-mêmes. Ce pouvoir, en miettes au niveau de la recherche, se trouve reconcentré au niveau des pouvoirs économiques et politiques. En quelque sorte, les scientifiques produisent un pouvoir sur lequel ils n'ont pas de pouvoir, mais qui relève des instances déjà toutes-puissantes, aptes à utiliser à fond les possibilités de manipulation et de destruction issues du développement même de la science."
Edgar Morin, Science avec conscience (1982)
E. Kant. Le Vivant n'est pas une simple machine
![]() Par
sgarniel
Le 25/11/2021
Par
sgarniel
Le 25/11/2021
« Dans une montre une partie est l’instrument du mouvement des autres, mais un rouage n’est pas la cause efficiente de la production d’un autre rouage ; certes une partie existe pour une autre, mais ce n’est pas par cette autre partie qu’elle existe. C’est pourquoi la cause productrice de celles-ci et de leur forme n’est pas contenue dans la nature (de cette matière), mais en dehors d’elle dans un être, qui d’après des Idées peut réaliser un tout possible par sa causalité. C’est pourquoi aussi dans une montre un rouage ne peut en produire un autre et encore moins une montre d’autres montres, en sorte qu’à cette effet elle utiliserait (elle organiserait) d’autres matières ; c’est pourquoi elle ne remplace pas d’elle-même les parties, qui lui ont été ôtées, ni ne corrige leurs défauts dans la première formation par l’intervention des autres parties, ou se répare elle-même, lorsqu’elle est déréglée : or tout cela nous pouvons en revanche l’attendre de la nature organisée. - Ainsi un être organisé n’est pas simplement machine, car la machine possède uniquement une force motrice; mais l’être organisé possède en soi une force formatrice, qu’il communique aux matériaux, qui ne la possèdent pas (il les organise) : il s’agit ainsi d’une force formatrice qui se propage et qui ne peut pas être expliquée par la seule faculté de mouvoir (le mécanisme). »
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1790)
H. Bergson - Conscience Mémoire Anticipation
![]() Par
sgarniel
Le 25/10/2021
Par
sgarniel
Le 25/10/2021
« Mais, qu'est ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la caractériser par son trait le plus apparent: conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut manquer d'ampleur: elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé; elle peut ne tenir que ce qui vient d'arriver; mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant : comment définir autrement l'inconscience? Toute conscience est donc mémoire, - conservation et accumulation du passé dans le présent.
Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment: vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente , et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. L'avenir est la; il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui: cette traction ininterrompue , qui nous fait avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiétement sur l'avenir.
Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent, si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite , purement théorique, qui sépare le passé de l'avenir; il peut être à la rigueur conçu , il n'est jamais perçu; quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties : notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé nous sommes appuyés, sur notre avenir nous sommes penchés: s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient. Disons donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. »
Henri Bergson, L’énergie spirituelle, 1919
A. Schopenhauer : Identité et Volonté
![]() Par
sgarniel
Le 25/10/2021
Par
sgarniel
Le 25/10/2021
"Sur quoi repose l'identité de la personne ? Non pas sur la matière du corps : celle-ci se renouvelle au bout de quelques années. Non plus sur la forme de ce corps : elle change dans son ensemble et dans ses diverses parties […]. - On admet généralement que l’identité de la personne repose sur celle de la conscience.
Si on entend uniquement par cette dernière le souvenir coordonné du cours de notre vie, elle ne suffit pas à expliquer l’autre . Sans doute nous savons un peu plus de notre vie passée que d’un roman lu autrefois ; mais ce que nous en savons est pourtant peu de chose. Les événements principaux, les scènes intéressantes se sont gravés dans la mémoire ; quant au reste, pour un événement retenu, mille autres sont tombés dans l’oubli. Plus nous vieillissons, et plus les faits de notre vie passent sans laisser de trace. Un âge très avancé, une maladie, une lésion du cerveau, la folie peuvent nous priver complètement de mémoire. Mais l’identité de la personne ne s’est pas perdue avec cet évanouissement progressif du souvenir. Elle repose sur la volonté identique, et sur le caractère immuable que celle-ci présente. C’est cette même volonté qui confère sa persistance à l’expression du regard. L’homme se trouve dans le cœur, non dans la tête."
SCHOPENHAUER, Le Monde comme volonté et comme représentation, 1819
John Locke : Identité personnelle
![]() Par
sgarniel
Le 25/10/2021
Par
sgarniel
Le 25/10/2021
"Cela posé, pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, il faut voir ce qu'emporte le mot de personne. C'est, à ce que je crois, un Être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut consulter soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux ; ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions, lequel est inséparable de la pensée, et lui est, ce me semble, entièrement essentiel, étant impossible à quelque Être que ce soit d'apercevoir sans apercevoir qu'il aperçoit. Lorsque nous voyons, que nous entendons, que nous flairons, que nous goûtons, que nous sentons, que nous méditons, ou que nous voulons quelque chose, nous le connaissons à mesure que nous le faisons. Cette connaissance accompagne toujours nos sensations et nos perceptions présentes : et c'est par là que chacun est à lui-même ce qu'il appelle soi-même. [...]
Car puisque la conscience accompagne toujours la pensée, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante : c'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un Être raisonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne : le soi est présentement le même qu'il était alors : et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se la remet à présent dans l'esprit."
Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain (1690)
![]() Par
sgarniel
Le 09/04/2021
Par
sgarniel
Le 09/04/2021
" Quant à savoir s'il existe le moindre principe moral qui fasse l'accord de tous, j'en appelle à toute personne un tant soit peu versée dans l'histoire de l'humanité, qui ait jeté un regard plus loin que le bout de son nez. Où trouve-t-on cette vérité pratique universellement acceptée sans doute ni problème aucun, comme devrait l'être une vérité innée ? La justice et le respect des contrats semblent faire l'accord du plus grand nombre ; c'est un principe qui, pense-t-on, pénètre jusque dans les repaires de brigands, et dans les bandes des plus grands malfaiteurs ; et ceux qui sont allés le plus loin dans l'abandon de leur humanité respectent la fidélité et la justice entre eux. Je reconnais que les hors-la-loi eux-mêmes les respectent entre eux ; mais ces règles ne sont pas respectées comme des lois de nature innées : elles sont appliquées comme des règles utiles dans leur communauté ; et on ne peut concevoir que celui qui agit correctement avec ses complices mais pille et assassine en même temps le premier honnête homme venu, embrasse la justice comme un principe pratique. La justice et la vérité sont les liens élémentaires de toute société : même les hors-la-loi et les voleurs, qui ont par ailleurs rompu avec le monde, doivent donc garder entre eux la fidélité et les règles de l'équité, sans quoi ils ne p"ourraient rester ensemble. Mais qui soutiendrait que ceux qui vivent de fraude et de rapine ont des principes innés de vérité et de justice, qu'ils acceptent et reconnaissent ? "
John Locke, Essai sur l'entendement humain (1689)