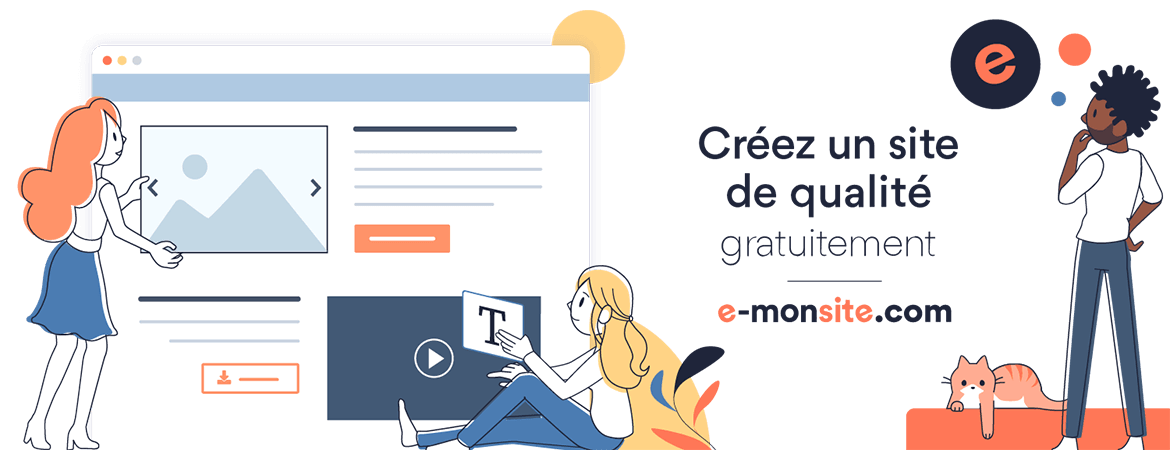- Accueil
- Humanités Littérature Philosophie
- HLP Term. La Recherche de Soi
HLP Term. La Recherche de Soi
- La recherche de soi
Introduction
La question du sujet est une question fondamentale de toute anthropologie. Elle engage une certaine conception de l’homme et de l’humanité, mais aussi une idée de la conscience que l'on a de soi. La conscience de soi implique une représentation de soi, mais aussi une conception du genre humain. La conscience de soi est ce qui définit spécifiquement l'être humain, elle est un élément essentiel de notre anthropologie.
La question du sujet est ainsi la question de la Modernité par excellence : elle émerge du doute cartésien (17ème siècle) et s'impose comme la première évidence, la seule certitude sur laquelle nous puissions fonder notre science. Ainsi, le sujet devient ce point fixe à partir duquel va se construire une certaine idée de l'homme : être de Raison, transparent à lui-même et libre.
Plus d’argument d’autorité, penser par soi-même, mettre en doute tout ce que l’on sait
Tester ses connaissances
Seule certitude pour Descartes = je pense donc je suis, cogito / propre de l’homme – uniquement à celui-ci
Sciences de l’esprit
Liberté
L’année dernière = parole propre de l’homme
Question de cette année = l’homme comme sujet / quel sujet ? Comment le définir ?
S’il est certain que l’être humain est le seul à avoir conscience de sa volonté et de son action, peut-on néanmoins dire qu’il se connaît lui-même ?
Limites à la connaissance de soi / limites à la transparence de la raison
Problématique : si l’on doit se cherche, chercher le soi, c’est qu’il n’est pas donné d’emblée
Travail sur soi = devenir soi, s’accomplir, accomplir sa nature
Ou au contraire devenir plus que soi, devenir un autre ?
Implications = l’être humain est perfectible (Rousseau) – susceptible de s’améliorer par lui-même
Ce que dit Jean-Paul Sartre dans l’existentialisme est un humanisme « l’homme n’est pas un chou-fleur, une mousse, une pourriture » il est un projet
Il se définit par son existence et son existence le définit
Importance de l’Histoire aussi
Importance donc de l’éducation = instruction, transmission des savoirs, mais aussi éducation aux valeurs, à la morale ou encore à la liberté et à l’autonomie
L’éducation semble s’adresser avant tout à la raison, à l’intelligence --- le corps, les sens ?
Le soi ne semble pas se résumer à la raison et à la logique – c’est la position des Romantiques, ce sera aussi celle des Surréalistes
Quelles facultés nous permettent de nous améliorer ? La Raison ou la Sensibilité, l’expérience ou la logique ? Question de la place accordée à la sensibilité : aux sens, aux sentiments
Texte 1. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception
- Éducation, Transmission, émancipation
Distinguer les différents éléments de l’éducation
Étymologie ex-ducere latin conduire, guider hors de soi
Mot récent qui remplace élever
- Conditions de l’Éducation
1ere condition
Préoccupation humaniste complétée par les Lumières
Former, apprendre
Dès Érasme et Rabelais éducation humaniste : latin, grec
« On ne naît pas homme, on le devient »
2eme condition : invention de l’enfance
Montaigne « j’en ai perdu en nourrice deux ou trois, sinon sans regret, au moins sans fâcherie. »
Philippe Ariès L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime
L’enfant au MA passait de la quasi-inexistence à l’âge adulte directement
Invention de la famille et de l’affection familiale (rôle de l’Eglise)
Distinction des âges : nourrisson, enfant, adolescent, adulte
Invention de la scolarisation comme mise à part de l’enfant, avant le passage au monde adulte
Mise en quarantaine pour être normé, formé – sentiment de l’utilité sociale
3eme condition
Invention de l’État / Gouvernement des populations sur un territoire
Statistiques
Baisse de la mortalité infantile et Démographie
Dès le XVIIe siècle – Rationalisation du traitement des populations
Grand renfermement (Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique -1961)
Contrôle social / Hôpitaux, Casernes, Écoles
Gestion des multitudes
Former les citoyens pour l’État, pour la République (IIIe République 1870 – 1940)
- Paradoxes du processus éducatif
Les moments de l’éducation et l’éducation pour quoi faire ?
Texte 2. Emmanuel Kant, Traité de pédagogie
Les élèves identifient les moments du processus d’éducation
Distinction des concepts Instruction, éducation
---- Y a-t-il une opposition entre les moyens et les finalités de celle-ci ?
Débat
- Les disciplines et la formation des individus
Texte 3. Michel Foucault, Surveiller et punir
Organisation de la classe – Normalisation et Hiérarchisation de la masse
Annexe. Ne peut-on enseigner que ce que l’on sait déjà ?
Texte 4. Jacques Rancière, Le Maître ignorant
- Les expressions de la sensibilité
Depuis Descartes, le sujet est défini par la Raison : je pense donc je suis (je suis un être qui pense). De même, les penseurs des Lumières ont établi que l'individu devait prvilégier la rationalité et l'autonomie de la pensée. La devise des Lumières est ainsi "Ose penser par toi-même", il s'agit de se passer de tuteurs et d'accéder à ce qui caractérise l'être humain : ses capacités intellectuelles, son jugement et sa raison.
Ce privilège accordé à l'esprit est en même temps une mise de côté du corps et des sens. Ceux-ci nous reconduisent au monde de l'animal et tout le souci de cette anthropologie issue de l'âge classique est de distinguer l'homme de l'animal. Les sensations, mais aussi les sentiments et les émotions, sont ainsi reléguées au second plan et ne correspondent pas à une spécificité humaine. Il faut ici souligner que cette disqualification des sens et des affects est visible aussi dans les partages que l'on fait au sein de l'humanité elle-même : ainsi les femmes sont-elles systématiquement accusées d'être sous l'influence de leurs passions et de leurs sentiments, ce qui s'oppose à la rationalité masculine ; de même, les populations désignées comme primitives sont elles aussi renvoyées aux sens et aux passions, ce qui souligne leur animalité supposée. Les sens et les facultés corporelles sont donc à la fois l'objet d'une dépréciation et le signe d'une minoration de certains sujets.
Cet empire de la raison, qui s'affirme à partir du XVIe siècle et dont le privilège est confirmé par les Lumières au XVIIIe siècle, correspond à la perspective moderne d'une mathématisation du monde : les sciences s'établissent sur ce modèle mathématique censé rendre compte de l'enchaînement mécanique des événements et des choses de ce monde. Seul l'homme est capable de liberté et donc lui seul échappe au déterminisme des lois de la nature. Si cette perspective moderne a le mérite de chasser les superstitions et d'inaugurer une méthode scientifique rigoureuse, elle conduit néanmoins à ce que le sociologue Max Weber désigne comme le "désenchantement du monde". La raison semble coupée du reste des phénomènes et des êtres vivants : elle s'enferme dans une forme de solipsisme : il n'y a plus pour le sujet pensant, d'autre réalité que lui-même.
Comment alors concevoir une relation entre la nature et l'homme qui ne soit pas désincarnée ? Comment rendre compte de l'importance de notre rapport au monde et à la nature ? Refuser toute valeur aux sens et aux sentiments, comme communication et participation au monde extérieur, c'est sans doute amputer le sujet d'une part de son être. En effet, Descartes lui-même est averti de la situation particulière de l'homme composé de deux substances : le corps et l'âme. Cette situation qui nous fait être au monde est aussi ce qui permet de nous définir et doit être prise en compte dans la connaissance de soi.
**********
Face à la tentation d'une absolutisation de la raison, tendance du positivisme moderne, le Romantisme peut nous indiquer la voie d'une critique féconde. En effet, le Romantisme, tel qu'il apparaît au début du XIXe sicèle est avant tout une réaction à ce qu'il identifie comme un manque de spiritualité. Bien sûr, les Lumières accordent à l'homme cette spiritualité, mais ils la refusent au monde qui nous entoure. Pour les Romantiques, la nature elle-même est porteuse de spiritualité et elle communique à notre Moi des émotions, des sentiments, des sensations qui sont comme un langage. La nature est dans cette vision romantique le symbole d'une spiritualité qui nous dépasse et dans laquelle l'existence individuelle prend seulement sens. Refuser cet enseignement de la nature, c'est refuser le message divin d'un appel à la modestie et à la retenue ! C'est le sens des grands romans du romantisme noir que sont Frankenstein de Mary Shelley ou les contes d'Hoffmann par exemple, mais aussi du Faust de Goethe : la vanité humaine face à la nature et à la création divine conduit le héros romantique à sa perte. Le Romantisme affirme l'importance des sentiments et consigne l'exaltation des passions humaines jusqu'à faire une part au fantastique et à l'irrationnel.
Cette nouvelle perspective sur le monde désormais peuplé d'esprits et de fantômes, est aussi une nouvelle conception du sujet et du soi. Pour les Romantiques, la Raison ne suffit pas à comprendre et définir le sujet. Celui-ci ne peut se comprendre que dans ses relations avec le monde qui l'entoure, au coeur d'une nature porteuse d'une spiritualité presque religieuse : Jean-Jacques Rousseau, auteur pré-romantique, formule dans ses Rêveries d'un promeneur solitaire cette sentimentalité de l'existence. Il y évoque un état de contentement que le sujet découvre en s'abandonnant à ses rêveries au coeur de la nature, au bord de l'eau : le plaisir du simple sentiment de l'existence. Il s'agit donc de valoriser cette fois-ci un sujet qui s'abandonne à ses sensations et ses sentiments et qui refuse l'hégémonie et les préoccupations ordinaires de la Raison.
Se mettre à l'écoute de soi et du monde, tel est le programme de ceux qui refusent un désenchantement du monde qui nous couep de la nature et du sens de notre existence.
Cette découverte du cogito conduitÊtre sensible à sa propre existence / Sensibilité aux autres et à la nature
Renversement romantique : place accordée à la Raison depuis l’âge classique et surtout depuis les Lumières ----- > Importance des sentiments et des sensations
- La révolte romantique : le sujet et la sensibilité
Le Romantisme constate un désarroi lié à la rationalisation du réel, un désenchantement du monde qui fait que celui-ci ne leur suffit plus
Manque de spiritualité / Manque de Sentiments / Manque de fantastique et d’irrationnel
Lien entre expression des sentiments et expression du Moi / Existence
Révolte du sentiment contre la Raison abstraite / Sturm und Drang (fin XVIIIe s.) **** Goethe /
Époque des contes d’ETA Hoffmann / inspiration gothique Der Sandmann – Olympia
Romantisme anglais 1764 Horace Walpole Le château d’Otrante
Ann Radcliffe Les Mystères d’Udolphe ****** Walter Scott*
Lord Byron jusqu’à Shelley – Mary Shelley Frankenstein ** Percy Shelley poète romantique
1847 Charlotte Brontë Jane Eyre et Emily Brontë Les Hauts de Hurlevent
L’importance accordée aux sentiments et à l’exaltation des passions est aussi une nouvelle perspective prise sur le Moi, sur le sujet, dont la Raison ne suffit pas à rendre raison
Raison et Sentiments (Jane Austen) s’opposent mais caractérisent une époque où l’on voit à la fois le triomphe de la raison et des Lumières et celui de le Liberté et des passions – Hegel « rien de grand ne s’est accompli sans passion » Exemple de Napoléon
Texte 5. Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du Promeneur Solitaire
En France ------ Mme de Staël De l’Allemagne 1810 – Découverte des romantiques allemands Goethe Schiller //// Adolphe de Benjamin Constant
Alfred de Musset Lorenzaccio – Lamartine //////// Lyrisme
Poète maudit / mort jeune
La Modernité comme Attitude (Baudelaire)
- Qu’est-ce que la sensibilité
Sensation / Sentiment / Sensibilité
A l’origine de nos idées
Texte 6. David Hume, Traité de la nature humaine
- Le souci de soi : sentiment de soi-même et des autres
Sensible à soi – Souci de soi
Sensible à la beauté / Esthétique de Soi ****** ouverture aux autres et au monde
Prendre soin de soi / Souci de Soi
Texte 7. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)
Retrouver sous le Soi mis à distance, ce Soi vécu qui est notre corps
Hypothèse du Soi naturel
Actualité de la sensibilité / Perspectives féministes
L’éthique du care est une nouvelle manière d’appréhender les questions morales à partir du constat de l’importance des relations de solidarité, de sollicitude que l’on développe à l’égard d’autrui dans toutes les sociétés. Elle est née des réflexions des féministes américaines Carol Gilligan, Une voix différente (In a Different Voice) publié en 1982, l’autre avec Nel Noddings, Caring, publié en 1984.
« Si l’éthique de Gilligan a réellement marqué son temps, eu un impact fort sur l’évolution des sciences humaines depuis plusieurs années et suscité une explicitation politique du concept de care, y compris en France, l’orientation proposée par Noddings est, quant à elle, restée plus marginale, car elle s’enferme dans un naturalisme féminin que la norme du soin, enracinée dans le maternage, construit. » QSJ ? Fabienne Brugère
Nel Noddings Caring Revaloriser des orientations morales dévaluées et associées aux valeurs féminines – minorées et dépréciées
La morale n’est pas qu’une question de logique – sentiments, valeurs humanistes
De même, elle n’est pas simplement individuelle voire individualiste, au contraire elle est aussi collective
Il s’agit de deux pôles de la morale dont un a été négligé et relégué dans les marges de la société
Pourtant le soin, l’attachement, l’attention portée aux autres demeurent des valeurs importantes dans la construction de soi – éducation, famille, école – et dans la construction des liens sociaux
Mais ce fonctionnement réel indéniable de la vie concrète éthique est refoulé – seules sont valorisées les principes individualistes et masculins de la logique individuelle (masculins par culture)
L’idée du care c’est de montrer que sans ces relations éthiques négligées une société ne tient pas !
De même que les sociologies de l’anti-utilitarisme (MAUSS – Alain Caillé) ont montré que sans des relations symboliques de reconnaissance la société ne tiendrait pas – les relations d’argent ne font pas tout et ne fonctionneraient pas sans d’autres relations qui sont cachées et minorées
Le travail ne fonctionnerait pas sans le travail caché des femmes
Il s’agit aussi de répondre à une volonté démocratique, une volonté d’égalité : il ne faut pas que la réussite des uns se paie de l’échec des autres, que l’inclusion des uns se paie de l’exclusion des autres, etc.
Donner voie au chapitre à toutes les éthiques – même celle des plus vulnérables
Vulnérabilité
Annexe. Sensibilité et imaginaire : Quelle place faire à l’imaginaire dans la définition de Soi ?
Définition de l’imagination et de l’imaginaire
Imagination = faculté de produire des images fictives qui naissent d’une recomposition, d’une modification des sensations et des sentiments réels – capacité de produire des images d’êtres chimériques, de construire par la pensée des sensations qui diffèrent des sensations réelles, de susciter aussi des sentiments, des émotions nouvelles qui n’ont qu’un rapport indirect avec l’expérience réelle.
Imaginaire = l’ensemble des images, des ambiances, des émotions, des représentations produites par l’imagination et qui constituent un monde parallèle au monde réel. L’imaginaire constitue néanmoins un monde dont nous pouvons faire l’expérience, comme le monde du rêve ou le monde de l’art.
L’imagination constitue une faculté importante de l’individu qui lui permet d’exprimer sa créativité, consciemment ou inconsciemment, par la production d’images fictives – On peut s’accorder sur le fait que cette créativité est en même temps une manière d’expression de l’individu qui révèle son intimité, des sentiments et sensations personnels, sa sensibilité particulière au monde.
L’imagination fait ainsi partie de ce qui permet de définir le sujet, le Moi, au-delà de la simple expression de la rationalité qui le caractérise. Comprendre ce qui constitue et nourrit l’imagination du sujet permet de mieux le connaître – Part d’inconscient que la psychanalyse et Freud ont révélé.
*****
Exemple de l’art – production d’une « image », d’une œuvre qui recompose la réalité pour en fournir une représentation.
Imagination et artiste :
- manifestation d’un savoir-faire dans la construction de ce monde imaginaire
- expression de la sensibilité individuelle de l’artiste
- expression de l’inconscient collectif
- expression de l’inconscient psychique de l’artiste
*******
C’est le principe du surréalisme : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi. » Manifeste du surréalisme de 1924
Renouveler la production consciente d’images, d’œuvres d’art, de fictions en se connectant aux puissances inconscientes du désir, des pulsions, des rêves.
Importance du rêve : les Surréalistes – part de l’inconscient
Découverte de l’inconscient
Texte 8. André Breton Manifeste du Surréalisme de 1924
Le groupe surréaliste est créé en 1919 par André Breton et ses amis Philippe Soupault, Louis Aragon et Paul Eluard autour de la revue Littérature. Il naît d’une volonté commune d’effectuer une révolution esthétique, de libérer l’art des contraintes de la raison et d’explorer les domaines de l’imaginaire et de l’inconscient.
Breton s’appuie sur les récents travaux de Freud, comme il le dit dans Manifeste du surréalisme (1924).
Les membres du groupe veulent que l’œuvre soit le produit d’un « automatisme psychique pur » et non plus le fruit de la volonté de l’artiste. Ils mettent alors en place un certain nombre de techniques pour parvenir à faire surgir des images ou des idées venues de leur inconscient càd non affiliées aux formes et principes de la rationalité – il s’agit de dégager les images et les expressions de soi des limites de la morale, de la religion, des censures diverses pour révéler une dimension refoulée ou censurée : notamment celle des désirs, des pulsions – pulsions de mort, pulsions sexuelles-, de la violence.
Partie censurée de Soi
Techniques sollicitées : écriture automatique, cadavre exquis, récits et analyse de rêves, sommeil hypnotique, collage, etc.
Travail à proposer aux élèves : chercher à deux des arguments permettant de répondre à la question suivante -
Question de réflexion philosophique = « A partir des éléments soulignés par le texte d’André Breton, montrez en quoi l’expression de l’imagination peut aider à une meilleure connaissance de soi ? »
- Les métamorphoses du Moi
Intro. Les métamorphoses du Moi en art
D’Homère à Marie Darrieussecq, d’Ovide à Kafka, les métamorphoses parcourent l’histoire de la littérature
Histoire de l’art : Cindy Sherman
Symboles d’une part cachée de l’individu / Caractère performatif du sujet
- Le Moi et la Multitude
Le Moi n’est pas défini et s’expérimente dans la multitude : multitude des sensations, des pensées, des actes.
Moi performatif – Judith Butler
Existentialisme Sartre – Garçon de café
Rôles et Points de vue
Texte 9. Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes
Moi comme rencontre de forces qui s’opposent et s’affrontent / Volontés et points de vue
- Le Moi & la Société
La socialisation construit le Moi en fonction des rôles et des attentes de la société
Poids des normes
Texte 10. Philippe Riutort, La Socialisation : apprendre à vivre en société (2013)
Texte 11. George Herbert Mead, L’Esprit, le soi et la société (1963)
Socialisation primaire et secondaire / Confrontation au pouvoir
Texte 12. Michel Foucault, Cours du 14 juillet 1976
Le sujet est un produit et un effet du pouvoir // retour à la question de l’éducation
Individuation et intégration des normes
Le sujet est un sujet du pouvoir : le pouvoir rassemble des données éparses (des actes, des qualités, des engagements, des références, une généalogie, une identité administrative, une sexualité, un âge, un casier ou une histoire) et constitue le sujet.
Le sujet est à la fois l’effet et la condition du pouvoir : il n’y a pouvoir qu’en constituant des individus sur lesquels il s’exerce et il n’y a d’individu que cerné et délimité par l’action des pouvoirs.
Plus essentiellement, le Moi est impliqué dans l’ensemble des pratiques et des relations de pouvoir de la société. Faut-il cependant limiter cette société aux humains ? Peut-on étendre ces relations de pouvoir et de détermination réciproque aux non-humains ?
- Métamorphoses du vivant
Texte 13. Emanuel Coccia, Métamorphoses (2020)
La métamorphose est à la fois ce qui nous sépare des autres vivants, des autres espèces, et ce qui nous y relie. Elle est l’autre nom de l’évolution.
Le premier signe de cette métamorphose est actif : en mangeant, j’intègre à mon Moi l’autre. Je transforme en Moi ce qui m’était étranger : animaux, plantes se transforment en éléments d’être humain. Nous transformons les autres en nous-mêmes.
Mais cette métamorphose comprend aussi la transformation de soi en autre chose : ne serait-ce que par la mort, nous nous transformons toujours en d’autres matières, d’autres vivants. Nous sommes nous-mêmes transformés par les autres.
Cette métamorphose constante qui est le propre du vivant, ou plutôt même du monde dans son ensemble, est en réalité ce qui constitue l’existence comme préparation de l’avenir, comme possibilité virtuelle. Nous la vivons individuellement, mais aussi en tant qu’espèce et en tant que partie de ce monde.
Conclusion
Nous l’avons vu, le Moi est en lui-même une « micro-société », c’est-à-dire que s’affrontent en lui des pulsions, des désirs, des forces qui le dépassent. Par ailleurs, le Moi dans sa métamorphose s’inscrit dans un milieu ou un contexte social qui le détermine. Le Moi est ainsi une performance, un phénomène social. Nous assumons les fonctions et les rôles que les attentes de la société nous assignent : pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, la Société dans laquelle s’inscrit la définition du Moi peut en réalité être élargie à l’ensemble du milieu social mais aussi naturel. Le Moi se définit et se transforme en contexte, en situation. Nous sommes nous-mêmes au milieu des autres et au sein d’un environnement naturel qui comprend les autres êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes ou même les éléments naturels.
Mais cet ensemble de facteurs qui influencent la manière de se représenter soi-même, de se connaître et d’exister, n’annule pas complètement la marge d’indétermination et de liberté que nous possédons. En effet, les métamorphoses du Moi s’établissent en fonction des règles sociales, du contexte vital dans lequel nous évoluons. Ces déterminations constituent les structures et les codes qui s’imposent à nous, mais que nous devons néanmoins interpréter : nous devons les comprendre et les intégrer, mais nous devons aussi les faire exister, comme un acteur interprète un rôle ou un musicien une partition. Les codes et les règles n’empêchent pas qu’il reste des marges de liberté, des manières de vivre, d’exprimer ma sensibilité, qui font de Moi ce que je suis, qui permettent les métamorphoses du Moi.
On peut ainsi dire que le Moi ne préexiste pas aux pouvoirs et aux ordres qui le déterminent, mais qu’il en constitue aussi la seule et unique réalité concrète. Les sujets font circuler et vivre les pouvoirs et les ordres et leurs « métamorphoses », leurs différentes formes constituent l’existence individuelle ainsi que l’histoire collective.
Conclusion générale
Nous avons entrepris de définir le Soi et d’en établir la genèse. Partant d’une contestation philosophique, artistique et littéraire de l’évidence de la connaissance et du sentiment de sujet, nous avons montré que la rationalité et l’identité ne pouvaient suffire à faire un portrait complet de celui-ci. En effet, le Moi se transforme, change, au cours de sa vie et au contact des autres, volontairement ou non. Comment rendre compte de ces changements du Moi ?
Par l’éducation et l’acquisition des apprentissages, nous nous transformons nous-mêmes : nous nous disciplinons et nous socialisons, mais nous sommes aussi capables de nous émanciper, de devenir plus libre et plus autonomes. Nous nous métamorphosons en adulte et en personne grâce à la transmission des savoirs et des méthodes.
Cependant, cette transformation intellectuelle et physique par la discipline et l’apprentissage, gagnerait à s’appuyer davantage sur la sensibilité de chacun et sur l’expérience pratique. En effet, la sensibilité est une part de nous-mêmes qui complète et enrichit notre rationalité et notre intelligence. C’est ce que souligne notamment le Romantisme au XIXème siècle. La sensibilité est une part de nous-mêmes qui comprend à la fois nos sens, nos sensations, et nos sentiments. Notre manière de percevoir le monde qui nous entoure est ainsi révélatrice de notre personnalité. Le Moi est ainsi constitué de la Raison et de la Sensibilité.
L’expression de notre sensibilité passe souvent par la mobilisation de l’imagination, notamment en art. Il s’agit alors d’exprimer les caractéristiques de notre sensibilité : celles dont nous avons conscience, mais aussi celles qui nous échappent. Ainsi l’imagination permet de saisir une part cachée du sujet, un inconscient qui est le réservoir de nos désirs refoulés et de nos pulsions. Afin de mieux se connaître, il est important de se soucier de cette part inconsciente du sujet que la psychanalyse nous apprend à « dompter ». L’inconscient et l’imagination sont aussi des éléments importants pour l’expression de soi comme le souligne le Surréalisme : ils permettent de rendre compte des métamorphoses du Moi.
Ces métamorphoses expriment en effet les forces, les désirs et les volontés qui traversent le sujet et qui mettent en cause son unité. Elles sont l’effet des conflits intérieurs à celui-ci, mais aussi le reflet des rapports de force qui lui sont extérieurs, des rapports sociaux et politiques. Enfin, elles relient le Moi à l’ensemble de la réalité qui l’entoure, constituée d’autres humains, mais aussi d’autres vivants.
Afin de mieux nous connaître et nous comprendre, nous sommes donc amenés à prendre en compte non seulement le sujet comme individu rationnel et conscient de lui-même, mais aussi la pluralité de ses expressions et de ses métamorphoses dans l’existence. Ainsi la recherche de Soi nous conduit à la reconnaissance des multiples facettes de chaque individu et des liens qui l’unissent aux autres et orientent ses multiples métamorphoses.
Ajouter un commentaire