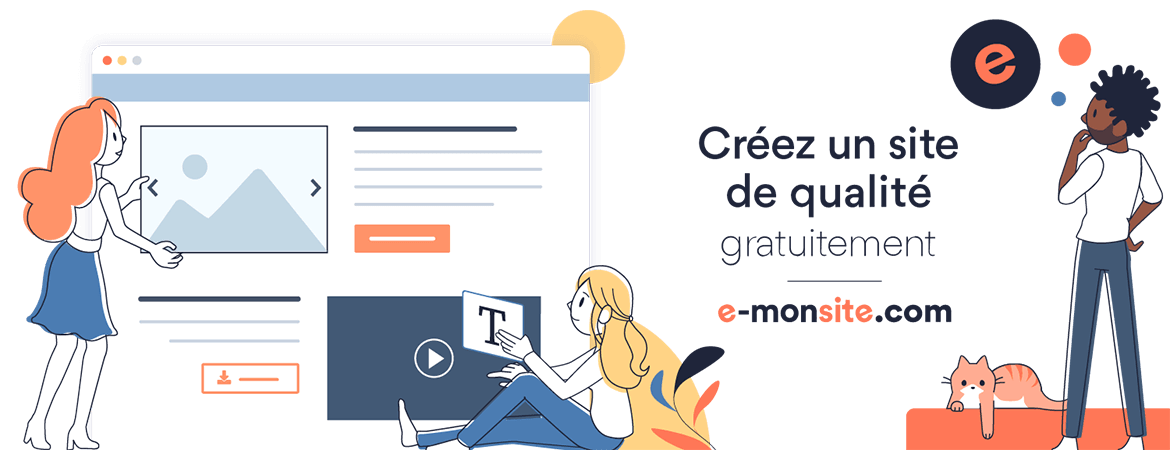- Accueil
- Cours Terminale Technologique
- La connaissance
- La Vérité (partie 1)
La Vérité (partie 1)
La Vérité (partie )
LA VERITE
La quête de la vérité témoigne d’un effort de l’esprit humain pour accéder à « ce qui est vraiment », la vérité authentique du monde dans lequel il vit. C’est une exigence de connaissance d’abord, une exigence théorique dont nous déterminerons les paramètres, un effort que nous reconnaîtrons notamment dans la science. Mais c’est aussi une exigence pratique (et non plus seulement théorique) : la connaissance doit être vraie car sur elle repose l’action, l’agir humain sur le monde. L’action ne semble pas pouvoir reposer sur le mensonge ou l’erreur.
Il s’agit d’abord de déterminer en quoi consiste le vrai : la vérité est-elle la réalité ? Est-elle un accord entre la réalité que je perçois et la connaissance ou la compréhension que j’en ai ? Nous verrons qu’il n’est pas si facile de se référer à la réalité, puisque d’une part, chacun à sa vision du monde et des choses, et d’autre part, il y a des obstacles à la saisie immédiate de la vérité. Enfin, par l’observation de la démarche scientifique, nous verrons quel statut accorder à l’expérience dans la connaissance.
Double exigence : la connaissance doit être vraie, atteindre la vérité. L’action doit reposer sur des conceptions vraies (pour être efficace, pour être morale…).
Questions préliminaires
La vérité est-elle simplement la réalité ?
Peut-on dire que tout ce qui est réellement est vraiment ? Ou la Vérité contient-elle une autre sorte d’exigence ? Laquelle ?
Dans quels domaines peut-on exiger la vérité ? Vérité et réel / Vérité et langage / Vérité et morale
Introduction
Nous avons tendance à identifier la vérité et la réalité : ce qui est vrai, c’est le réel et non l’imaginaire. Cependant, quand je regarde la réalité naturelle, je constate qu’elle est réelle : cet arbre est bien réel, cette pomme aussi. Pourtant, peut-on dire qu’ils sont vrais ?
L’affirmation de la réalité d’une chose ne fait que confirmer son existence. Le réel : c’est la chose (comme le confirme l’étymologie), alors que la vérité est un jugement sur cette chose. L’affirmation ne vise que l’existence dans le cas du réel : la réalité, c’est ce qui existe. L’ensemble des réels et l’ensemble des vérités, s’ils se recoupent (il y a une réalité vraie, comme une vérité réelle), ne se confondent pas… Alors que la vérité désigne une valeur que l’on accorde ou non à une proposition ou à une pensée. Nous pouvons déjà remarquer que la vérité n’est pas immédiate, qu'elle ne se donne pas d’emblée : elle nécessite un travail, une recherche. Pourtant, quand on tente de définir la vérité, on est conduit à réfléchir sur les rapports entre ces deux termes. La vérité nous apparaît déjà comme une construction qui met en jeu notre rapport à la réalité.
Définition provisoire : Pourtant, on le remarque dès le premier abord, la vérité entretient un rapport complexe avec la réalité. Elle ne peut se penser hors de la réalité, mais ne se confond pas avec elle. En effet, elle réside bien plutôt dans un rapport entre ma connaissance, mon savoir, mais surtout ma parole, mon discours et le réel. Il faudra établir bien sûr quel est ce rapport, comment peut-on le définir et quels sont les conditions d’un tel rapport de vérité ? La vérité s’établit dans ce lien entre la réalité et ce que j’en dis ou ce que j’en pense.
Elle peut se définir comme adéquation entre la pensée (exprimée dans le jugement ou conservée dans le savoir) et la réalité. C’est la tradition réaliste de la définition de la vérité telle qu’elle s’exprime depuis Aristote : « la vérité est la conformité de l’objet et de ce qui en est dit ». Descartes nous dit « la conformité de la pensée avec l’objet » (Descartes à Mersenne, lettre du 16 octobre 1639) ; elle « consiste dans l’accord de la connaissance avec l’objet » nous dit Kant.
"Le vrai et le faux sont des attributs du langage, non des choses.
Et là où il n'y a pas de langage, il n'y a ni vérité ni fausseté."
Hobbes, Le Léviathan, P. 1, ch. V (1651)
On peut affirmer par-là que la vérité est une valeur, une valeur que l’on accorde à certaines propositions portant sur la réalité et non à d’autres. Elle marque, comme un tampon, certains énoncés, certains discours. Elle valide nos jugements exprimés ou notre connaissance en les comparant avec la réalité, avec notre expérience de la réalité. C’est la vérité correspondance : correspondance entre le jugement et l’expérience.
Pourtant, nous savons que cette correspondance avec le réel n’est pas le seul critère de vérité. En effet, pour qu’une proposition ou un jugement soit reconnu comme vérité, il faut qu’il réponde à des critères de cohérence logique. Ainsi, par exemple, une vérité ne peut être contradictoire. Dans la philosophie moderne, telle que l’inaugurera Descartes, le chemin qui conduit à ces vérités est la Raison, elle est un principe de cohérence de la pensée avec elle-même, elle obéit aux lois formelles de la logique.
C’est une seconde définition de la Vérité qui se fait jour ici, non plus la vérité comme correspondance avec la réalité, mais comme vérité cohérence théorique. La vérité subjective n’est ainsi validée comme « vérité vraie » que si elle participe d’une vérité commune, universelle et objective révélée par la raison. Il nous appartient donc de trouver un chemin qui nous conduise à cette vérité.
Comment s’articulent alors les conditions de la vérité entre expérience et raison ? Cela constituera la première partie de notre interrogation du concept de vérité.
La vérité est donc semble-t-il une valeur établie à la fois par la raison ou par l’expérience selon des modalités qu’il nous appartient de définir. Elle s’établit en opposition avec le mensonge, les préjugés et l’illusion et cherche à poser une évidence, à trouver une certitude qui soit au moins un point de départ.
Nous reconnaissons néanmoins que cette vérité n’est pas donnée immédiatement, puisqu’il faut la chercher en trouver les critères et la reconnaître… Nous ferons l’expérience d’une opposition à la vérité que nous avions abordée avec Socrate comme croyance (« je crois que je sais, mais je ne sais pas vraiment »). Nous nous attacherons donc à montrer ce qui peut faire obstacle à cette vérité en étudiant la question de la croyance et de l’illusion.
1. Raison ou expérience : deux sources concurrentes de la certitude
a) La règle de l’évidence selon Descartes
La première des Règles pour la direction de l’esprit dans sa quête de la certitude et de la vérité consiste, selon Descartes, à ne prendre pour objet et à ne considérer comme vrai que ce qui résiste au doute. Nous verrons que pour lui seul peut être reconnu comme vrai « ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de la mettre en doute » (Discours de la méthode).
L’idée claire et distincte ou idée évidente est saisie dans un acte d’intuition rationnelle. Elle seule permet d’échapper au doute et de déployer les chaînes de raison du discours à partir de son évidence. L’évidence seule peut fonder la certitude selon Descartes.
Le modèle proposé par Descartes est celui des mathématiques et de la géométrie, nous retrouverons ce modèle de scientificité au cours de notre parcours. Le projet cartésien est d’expliciter la méthode des mathématiciens et d’en faire le modèle de toute science. La réussite des mathématiques tient en ceci qu’elles procèdent selon un ordre précis : partant des intuitions des évidences premières, elles opèrent par déduction à partir de ces évidences. D’où la rigueur de leurs raisonnements et la certitude de leurs conclusions. La révolution cartésienne consiste à envisager la science comme une mathématique universelle
Selon Descartes, le fondement de la connaissance ne peut être l’expérience, comme l’affirment les empiristes, car elle ne peut fonder rien de certain. Il faut se tourner du côté de la raison : c’est une profession de foi rationaliste.
Définition de l’évidence : Caractère interne d’une vérité qui fait que je ne peux lui refuser mon adhésion.
Descartes, philosophe du XVII° siècle (1596 - 1650) est comme tout philosophe, en quête de vérité, il désire accéder à une vérité certaine et irréfutable car tout ce qu'il a pu apprendre lui laisse un sentiment d'insatisfaction, sa démarche est d'une certaine façon assez proche de l'attitude socratique dans la mesure où il a l'impression de ne posséder qu'une illusion de savoir et non un savoir véritable.
Comment juger, mesurer le degré de vérité de ce qu'il a appris ? En recensant les différentes sources de connaissance et en les soumettant à l'épreuve du doute. Nous allons suivre Descartes dans sa démonstration.
Descartes dans Le Discours de la Méthode (1637) s'interroge sur ce qui pourrait fournir un fondement certain pour les sciences. Il est donc à la recherche d'une vérité incontestable et pour la trouver, il utilise le doute méthodique.
Comment échapper au doute ? Quelle certitude résiste au Doute ?
Descartes va passer le savoir et la connaissance auu crible du doute. Ila va utiliser le doute sceptique pour remettre en question nos connaissances. Pour Descartes, il ne s'agit pas d'être réellement un sceptique, mais d'utiliser le doute comme outil pour découvrir le Vrai. Ne sera considéré comme vrai que ce qui résiste au Doute… Dans le Discours de la Méthode, il va entreprendre une démarche caractéristique. Ainsi, met-il en doute d'abord les données de l'expérience sensible.
Ainsi, il commence par préciser son projet : fonder les sciences et la philosophie sur la recherche d'une vérité absolue et irréfutable. Il distingue ainsi les règles qui régissent la morale et les mœurs, de celles qui doivent être respectées dans les sciences. Descartes veut trouver un point fixe qui lui permette de reconstruire les savoirs dont il doute d'abord. Il recherche un fondement rationnel à l'entreprise même de connaissance du réel.
Première source de connaissance : les sens
Il va tester à tour de rôle les deux sources possibles de la Vérité. D'où vient la Vérité ? Est-ce des sens ? D'abord Descartes s'attache à la sensation. Parce que nos sens nous trompent quelquefois, Descartes va supposer qu'ils nous trompent toujours. Ex : les illusions d'optique, les songes ou les délires des fous. Le fait que lorsque je rêve, je n'ai pas toujours conscience de rêver peut me conduire à penser que la différence entre le rêve et la réalité est illusoire et donc à douter de ce que je saisis par le témoignage des sens. Je ne peux affirmer avec certitude que ce que je perçois par les sens est vrai, j'ai au moins une raison d'en douter.
Une fois disqualifiées les connaissances qui proviennent des sens, que me reste-t-il ? Toutes les connaissances proviennent-elles des sens, comme l’affirment les empiristes ? Ainsi Locke dira-t-il que « Rien n’est dans l’entendement qui n’ait d’abord été dans les sens.» John Locke, Essai sur l’entendement humain (1689). Pour Descartes, il existe des vérités que mon esprit tire de lui-même, des intuitions rationnelles. L’esprit humain n’est pas une tabula rasa, une table rase. Il existe des idées innées.
Deuxième source de connaissance : la raison
Il va aussi considérer que les principes logiques, les démonstrations sont parfois erronées, donc si nous pouvons parfois douter, c'est que l'on ne peut être certain.
Nous ne pouvons donc être certains ni des informations qui proviennent des sens, ni des démonstrations qui viennent de la Raison. Descartes révoque en doute la Raison et l'Expérience. Il les réduit à n'être que douteux, à pouvoir être crus ou non. La croyance dans le témoignage des sens est compromise. Même la croyance dans l'existence même du monde est suspendue. La croyance dans les règles de la Raison est incertaine.
Le doute de Descartes est hyperbolique, il est excessif. Descartes propose l’image suivante : supposons que, dans un panier de fruits, il se trouve des fruits pourris. Nous allons devoir faire le tri, et si nous ne voulons que des fruits parfaits, alors il va falloir éliminer tous les fruits qui présentent le moindre risque de pourriture.
Doute hyperbolique : Doute méthodique, radical, poussé à l'extrême. Il s'agit de considérer comme absolument faux ce qui n'est que douteux. Il s'agit donc d'un doute théorique et provisoire.
Mais alors que reste-t-il de vrai si même les intuitions logiques et mathématiques sont révoquées en doute ? Apparemment rien ! Ce que je perçois par les sens est faux, et même l'existence de mon corps est frappée de nullité. Ce qui m'apparaît comme des évidences intellectuelles n'est peut-être qu'un tissu de vérités illusoires ? Avec l'application du Doute, nous semblons arriver à une étape sceptique. C'est-à-dire qu'à ce moment, comme Descartes le dira dans ses Méditations, il n'y a rien de sûr, si ce n'est justement que tout est incertain.
Mais Descartes n'en restera pas là !
Solution cartésienne au Doute : la découverte du Cogito - le sujet de la connaissance
Mais cependant que je doute de tout, je continue à dire que je perçois, que je me persuade que tout est faux, que je doute. Toutes ces expressions ne témoignent-elles pas de la présence d'une volonté qui accepte de suspendre son jugement, c'est-à-dire de douter tant qu'elle n'est pas parvenue à une vérité certaine et indubitable. Cette présence est-elle susceptible d'être réfutée en doute ? Puis-je douter de l'existence de ce « moi » qui doute ?
Découverte du Cogito : Cherchant à refonder entièrement la connaissance, Descartes souhaite lui trouver un fondement solide, absolument certain. Cette recherche l'amène à la conclusion que seule sa propre existence, en tant que « chose qui pense », est certaine. C'est cette découverte qu'exprime le « cogito ». Cogito, ergo sum (Je pense, donc je suis). Unique certitude qui résiste à un doute méthodique et hyperbolique. Le doute hyperbolique n'est pas illimité. Cette affirmation est donc une exception au doute universel, une vérité indubitable, une première évidence. Je puis douter de tout sauf de la condition même du doute, c'est-à-dire de ma propre existence. Elle est une certitude se rapportant à l'existence du sujet connaissant conscient de lui-même.
« Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai ; je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. » Ce moi que découvre le cogito n'a donc rien de concret au sens où il désignerait un moi particulier et personnel (celui de Descartes), il s'agit d'un moi universel, du moi pensant en général comme condition de toute recherche et de toute connaissance, d'une intelligence pure.
Cette découverte de la réalité en soi de la pensée par la simple réflexion du sujet sur lui-même se présente donc comme une vérité première, comme une première évidence. Elle ne nécessite aucune démonstration, elle ne se déduit pas d'autre chose qu'elle-même. Elle s'offre à nous dans la clarté de l'évidence par sa résistance au doute. LA CONSCIENCE DE SOI EST LE MODELE DE TOUTE VERITE, DE « L’IDEE CLAIRE ET DISTINCTE ». Ainsi cette approche cartésienne de la conscience de soi et de la vérité conduit à affirmer la spécificité de l'être même de la pensée qui en se saisissant elle-même se découvre porteuse de vérité, d'une vérité première qu'aucun doute ne peut détruire.
Descartes a donc trouvé son point d’appui pour échapper au doute et fonder la science : l’évidence du cogito. Pourtant, des difficultés se font déjà jour : comment le sujet, le cogito, se rapporte-t-il aux objets qu’il étudie, qu’il veut connaître ? N’y-a-t-il pas un danger de solipsisme ou de subjectivisme absolu dans le cartésianisme. Finalement, tout est compris en fonction du sujet et rapporté à lui, à tel point que l’on pourra dire avec Berkeley que rien n’existe en dehors de ma perception. C’est le problème du dualisme que de penser l’union de l’esprit et du corps une fois que l’on a démontré qu’ils étaient deux substances totalement distinctes.
La vérité cartésienne est fondatrice de notre modernité et de la modernité scientifique. Descartes libère la nature de toutes les "petites âmes" et les intentions cachées qui faisaient obstacle à une investigation mathématique des phénomènes physiques. Le monde cartésien est un monde-machine (même les animaux sont pour lui de simples machines), connaissable et manipulable par les hommes qui deviennent "comme maîtres et possesseurs de la nature." Cependant, ayant réduit la matière à l'étendue géométrique, Descartes néglige l'aspect expérimental de la nouvelle physique de Galilée, ce que les philosophes des Lumières lui reprocheront.
b) Nos sens nous trompent-ils ?
Pour Descartes, on ne peut rien tirer de certain de ce que nos sens nous proposent. Mais les exemples de tromperies qu’il nous avance disqualifient-ils vraiment les témoignages de sens ? On peut en douter et reporter l’origine de l’erreur sur le jugement que porte la raison sur ceux-ci : c’est la thèse de Lucrèce dans De la Nature des Choses (Ier siècle av. JC)
Nos sens nous trompent-ils ? Nos sens ne peuvent nous tromper, c’est le jugement porté sur les sensations qui peut être erroné.
La source de la vérité est présentée par les deux auteurs comme opposée : pour l’un, Descartes, on ne peut rien tirer de certain de ce que nos sens nous proposent ; pour l’autre, d’où pourrait-on tirer la certitude, si ce n’est de nos sens même.
Pourtant, Lucrèce ne retire pas à la raison sa capacité à comprendre le réel. Mais il en fait la source de l’erreur ! Il faut bien appliquer sa raison à la réalité pour en connaître la vérité. Si Descartes retrouve Lucrèce en ce qui concerne l’exigence d’une méthode, il s’en écarte radicalement en séparant deux substances : la matière et l’esprit, les corps et la pensée. Ces deux substances selon Descartes sont séparées : la matière est ce qui est étendu, l’esprit est la pensée. Lucrèce est quant à lui un matérialiste, un atomiste. Pour lui, l’esprit est un corps composé des plus minuscules atomes.
Les corps premiers qui composent la nature sont les atomes (comme pour Epicure au IV s. av JC) et il n’y a rien dans celle-ci que le vide et ces atomes (atome signifie en grec « qui ne peut être coupé »). En se rencontrant, grâce au clinamen (déviation de leur trajet, inclinaison ou inclination), les atomes composent le monde.
Avec Lucrèce, mais avant lui avec Epicure et même avec les atomistes grecs comme Démocrite (Ve siècle av. JC), la philosophie propose un matérialisme absolu et radical (un matérialisme qui se passe même des Dieux), dont on ne retrouvera un écho que dans la philosophie moderne des XVIIIe et XIXe siècles. Ceci implique un certain nombre de conséquences quant aux conditions de la vérité et de l’évidence, selon la problématique qui nous intéresse ici. Les sens permettent une connaissance de la vérité du monde. L’expérience sensible nous fournit des informations, des phénomènes (apparaître) frappent nos sens et notre raison peut en découvrir la cause, le sens, par la raison.
Pour Lucrèce, les erreurs ne viennent pas des sens, mais de la raison qui sait mal interpréter leurs témoignages.
Nous retrouvons une telle opposition entre les empiristes, selon lesquels toutes les idées viennent de l’expérience, et les rationalistes (comme Descartes) qui voient dans la raison la source de la vérité, le point de départ de la connaissance.
*********
Conclusion
Entre la Raison et l’Expérience, nous avons identifié deux sources concurrentes de la valeur de Vérité. L’évidence des sens s’affronte à celle des principes logiques et il semble bien difficile de faire la part, dans notre connaissance, de ce qui provient de l’une ou de l’autre.
Pourtant, on pourrait, à la suite de Kant, montrer que la recherche de la Vérité à travers l’expérience sensible, est possible si l’on accorde un rôle actif au sujet connaissant, à la Raison. Pour Kant en effet, le problème est mal posé. Si la connaissance de l'objet en soi est impossible, la connaissance de l'objet pour nous, tel que défini par notre faculté de connaître, est possible. C'est le sujet, et non l'objet, qui pose lui-même les conditions de possibilité de la connaissance objective. Ainsi, l'objet pour nous est l'objet en tant qu'il se conforme aux concepts de notre entendement et aux formes de notre sensibilité. Ce n'est donc pas l'objet qui est au centre de la connaissance, mais le sujet (= "révolution copernicienne").
L'intérêt de la philosophie kantienne de la connaissance a été de mettre en évidence pour la première fois le rôle actif du sujet connaissant dans l'élaboration du savoir. La méthode scientifique est une méthode constructive et pas seulement déductive comme le pensait Descartes ou contemplative comme le pensait Platon. Nous verrons ainsi comment la science construit son objet, ou les conditions de vérité de son objet, dans le prochain chapitre portant sur la raison scientifique et notamment la méthode expérimentale.
Mais auparavant, nous devons nous interroger sur le contenu même de notre méthode dans la recherche de la vérité. En effet, nous nous éloignons d’une intuition immédiate de la vérité, puisque celle-ci nous apparaît comme un rapport actif entre la raison et l’expérience. La vérité se construit donc dans une activité de connaissance. La certitude n’est pas immédiate, et l’origine de l’erreur ou de l’illusion peut, elle-aussi, être attribuée soit à l’expérience sensible, soit nous l’avons vu, à un mauvais usage de la Raison. Mais quelles sont d’abord ces obstacles à la connaissance de la vérité qui nous obligent ainsi à la rechercher indéfiniment ? Comment expliquer l’existence (et la persistance) de ces obstacles, de ces croyances qui empêchent le libre développement de la rationalité scientifique ?
Ajouter un commentaire