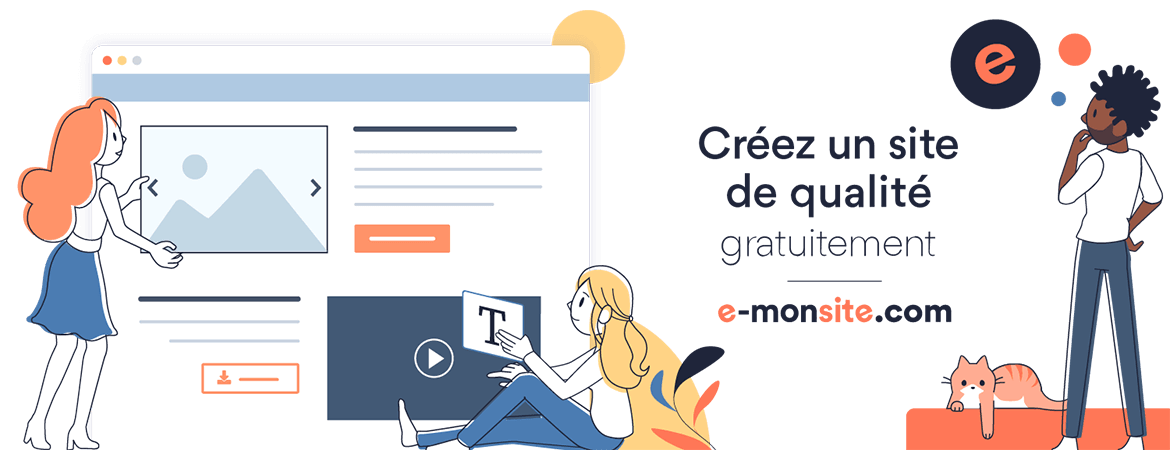- Accueil
- Humanités Littérature Philosophie
- HLP 1ère Les Pouvoirs de la Parole
HLP 1ère Les Pouvoirs de la Parole
Introduction
Quel est le rôle, quelle est la fonction de la parole dans les relations humaines : relations sociales, relations interpersonnelles ? La parole semble bien engager toujours une pluralité d’individus, de sujets parlants : elle est une forme de communication ou d’échange.
Ferdinand de Saussure (1857-1913) dans son Cours de linguistique générale, montre qu'il faut établir une distinction entre les trois phénomènes du langage, de la langue et de la parole. Le langage est ce qui comprend à la fois la langue et la parole. La langue est un système de signes, un code, ou encore l'ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer, alors que le parole désigne l'utilisation concrète de la langue par chaque individu.
La langue est le propre de l'être humain et ce qui le distingue des animaux. Elle est selon Aristote la marque de notre intelligence, de notre raison. Elle est ce qui permet à la société humaine de s'organiser rationnellement et de débattre. Si les animaux, ou même les plantes, ont bien des manières de communication, ceux-ci ne peuvent être confondus avec le langage humain. Il s'agit avant tout pour les autres êtres vivants d'envoyer des signaux, de lancer des alertes ou des avertissements. Si bien entendu, le langage humain n'est pas étranger à cette fonction d'avertissement et de signal, il faut y adjoindre d'autres fonctions qui le distinguent essentiellement de la communication animale. La langue est un système de signes et non de signaux, c'est-à-dire qu'elle est l'union conventionnelle d'un signifiant et d'un signifié. Le signe renvoie à une signification alors que le signal provoque une réaction. De plus, les signes permettent de composer des phrases et un ensemble de significations qui fonctionnent par différenciation réciproque, qui signifient les uns par rapport aux autres en fonction des contextes et des règles du langage et de la parole. Les signes sont arbitraires, ils varient selon les langues (au contraire des animaux qui disposent pour chaque espèce des mêmes signaux.
L'homme est un être de parole et c'est cette faculté qui fait justement son humanité. La parole constitue notre monde et notre rapport au monde et aux autres, comme l'analyse le phénoménologue Martin Heidegger (1889-1976) en 1957 dans son essai Acheminement vers la parole.
Comment représenter la parole ?
De prime abord, on pourrait imaginer représenter la parole comme un mouvement de communication :
Émetteur (destinateur) --------> Message -------------> Récepteur (destinataire)
Il faut bien entendu ajouter à cela le média ou le moyen de transmission (parole…) + code. Peut-être aussi l’effet retour de la parole --- la parole est une mise en relation, pourtant le modèle est plus complexe qu'un simple modèle communicationnel. En effet, l'analyse struturelle nous révèle la structure du langage et les fonctions du langage.
Analyse structurelle / Modèle de Roman Jakobson (linguiste russo-américain 1896-1982) – structure du langage
Le schéma structurel de Jakobson nous révèle l'impossibilité de faire une analyse sémantique de la parole en négligeant une de ces données. Le sens de la parole est établi à partir d'un sens en commun, conjuguant émotion et connaissance, information et méta-information, codage, indices et symboles. Le rôle de la symbolique dans la parole nous ouvre au sens poétique de celle-ci, c'est-à-dire à ce qui dans la parole échappe à la simple transmission d'un message. Le rôle de l'insistance, de l'emphase et des figures de rhétorique nous ouvre aux dimensions réelles de l'art de la parole.
Nous verrons donc comment se définit cet art de la parole qui joue avec les formes de celle-ci pour produire un effet. Il s'agira de notre première réflexion portant sur les Arts de la parole, sur la rhétorique, ses fonctions et ses méthodes. Mais cet art de la parole qui vise à convaincre, persuader, autant qu'à informer, s'appuie lui-même, nous le verrons dans un deuxième temps, sur des qualités que l'on reconnaît à la situation et au statut de celui qui parle. Il s'agit de s'intéresser à l'Autorité de la parole comme moyen de persuasion et comme lien entre pouvoir et parole. Enfin, la parole qui vise à convaincre peut aussi utiliser les armes de la séduction et du charme, au-delà de l'autorité. Il s'agira dans un troisième temps de montrer comment opère la Séduction de la parole, au-delà sans doute des principes de Vérité ou de Mensonge.
1. Les origines contrariées de la rhétorique : un art de la persuasion ou un art de raisonner ?
Afin de traiter de l'Art de la parole, nous nous interrogeons sur les origines de celui-ci. L'art de la parole, la Rhétorique, apparaît en Grèce aux alentours du Vème sicèle av. JC. Si bien entendu, l'art des discours existait auparavant, il se codifie et prend un nouveau relief dans l'Agora athénienne. Il est en effet nécessaire pour que se développe les arts de la parole, que l'on fasse une place dans la vie publique et sociale à l'exercice rhétorique. C'est le cas dans la démocratie grecque qui invite chaque citoyen libre à donner son opinion, à formuler ses arguments dans le cadre de débats publics. Ces débats peuvent concerner des affaires de justice ou de politique, mais aussi des questions scientifiques ou philosophiques pour lesquels les Grecs organisaient de véritables concours de rhétorique. Cette tradition sera reprise à Rome où l'art oratoire aura une grande place dans la vie publique et dans l'animation du Forum.
Les premiers rhéteurs dont nous gardions la trace sont justement les Sophistes grecs qui ont fait de la parole leur métier (ils sont rémunérés pour cela) et qui se vantent de pouvoir convaincre n'importe qui de n'importe quelle opinion. Ce relativisme des opinions est le coeur de leur querelle avec les premiers philosophes, dont Socrate et bientôt Platon. En effet, pour les philosophes, ce qui importe c'est bien la Vérité et la Justice. Il ne s'agit pas pour les philosophes de défendre une opinion, qu'elle soit vraie oufausse, mais bien de rechercher par le dialogue rationnel et logique, une vérité unique qu'il s'agit d'établir pour tous. Dans le dialogue de Platon, Gorgias, celui-ci fait un portrait assez fidèle des sophistes dont Gorgias est justement un éminent représentant : ce dernier présente sa discipline comme un véritable "sport de combat".
Malgré les condamnations des philosophes, la rhétorique est un art qui se développe et qui a du succès car il promet de triompher dans le débat public. Il faut distinguer selon Aristote (384-322) différents genres oratoires qui sont l'occasion pour le Sophiste d'exercer son art :
- Le genre judiciaire correspond aux plaidoyers devant les tribunaux et aux procès civils se déroulant au forum.
- Le genre délibératif qui s'exerce dans les affaires publiques au sein d'une assemblée délibérante ou d'un conseil.
- Le genre épidictique ou démonstratif qui est réservé aux éloges. Il s'agit notamment d'un art du discours exercé lors des Apologies funèbres prononcées par un membre de la famille lors de funérailles aristocratiques.
Quelle que soit l'occasion au cours de laquelle ils s'exercent, les arts de la parole visent un effet sur l'auditoire et l'on peut résumer avec Cicéron (106-43) les fonctions et les buts de la rhétorique ainsi : docere movere placere, c'est-à-dire éduquer, apprendre et émouvoir. Ils mettent en oeuvre un ensemble de moyens, ou parties de la rhétorique, qui seront codifiés par les auteurs latins, dont Cicéron, et qui regroupent Inventio (l'invention ou le choix de la matière à traiter), dispositio (la disposition ou l'organisation du discours), elocutio (l'élocution ou le choix des mots et des figures), memoria (la mémoire), actio (l'action ou la voix et le geste).
La querelle entre Sophistes et Philosophes
Même origine, parfois même technique (une forme de dialectique) /Mais but différent, orientation différente
Protagoras (490-420) « l’homme est mesure de toute chose » ; Gorgias (483-375)
Thrasymaque (459-) prétendait que, par nature, le faible n'a aucun droit sur le fort ; Calliclès, dont l'existence réelle est controversée, est aussi un archétype de cette tendance. Le recours fréquent à des joutes oratoires a amené Aristote à qualifier d’agonistique (d'ἀγών, signifiant « lutte ») cette pratique de la parole.
a. But selon Platon : la recherche de la vérité / But selon les sophistes : convaincre (raison, démonstration) ou persuader (croyance, émotion)
Pour Platon, dans le Gorgias, les sophistes sont des maîtres en tromperie. L’art du discours est-il un art de la tromperie ?
Muthos et logos : avec la naissance de la philosophie on passe du muthos au logos, du mythe à la raison. Socrate est le premier à rechercher l’essence des choses, des êtres : l’idée de la chose est son essence qui ne dépend pas des accidents ou de la sensation, perception.
Importance du logos chez Platon : défenseur de l’ordre rationnel – correspondance / monde des Idées – idéalisme qui préside à la naissance de la philosophie – rupture avec la religion et la croyance pour s’approcher de la vérité.
Dans la perspective ouverte par Platon, les sophistes ne sont pas des philosophes : ils enseignent sans savoir (Gorgias), ils ne sont pas au fait des questions éthiques et morales de Justice et de Bien, de Vertu (aretê). Ils n’ont pas rompu avec les croyances irrationnelles et surtout avec l’opinion (la doxa). Tout le travail philosophique selon Platon consiste à s’éloigner le plus possible des valeurs des sophistes : relativisme moral.
Il s’agit d’entendre par là que les beaux discours, les arts de la parole, ne sont pas des instruments philosophiques ou scientifiques. Ils ne délivrent aucun savoir propre, si ce n’est celui de tromper et de séduire, au prix du mensonge.
b. Pourtant Socrate (459-399) dépeint comme un sophiste par Aristophane (Les Nuées) – usage des techniques de la parole ?
Pourtant la méthode socratique telle que rapportée par Platon (428-348) est bien une méthode oratoire, mais qui se refuse à la rhétorique, au « beau discours »… exemple du Banquet.
Socrate utilise l'Ironie, l'art de poser des questions et de mettre en doute les connaissances par le dialogue. Mais la dialectique socratique vise aussi à la découverte de vérités ignorées grâce à la logique, ce que l'on appelle la Maïeutique : l'art d'accoucher (ici d'accoucher les esprits).
De plus, bien que Platon oppose philosophes et sophistes, ces derniers ont eu pour maîtres les philosophes présocratiques :
-
Gorgias : Empédocle Principe de l’univers, du cosmos : deux principes qui règnent cycliquement sur l'univers, l'Amour et la Haine. Ces principes engendrent les quatre éléments dont sont composées toutes les choses matérielles : l'eau, la terre, le feu et l'éther (ou l'air). Métempsychose Transmigration – végétarisme (Pythagorisme)
-
Protagoras : on le rattache à Démocrite (légende ?) – atomisme, matérialisme et une forme de relativisme ou de scepticisme. Protagoras serait l’inventeur des discours éristiques (disputes – disputatio latine) et rhétorique (art oratoire) – « L’homme est mesure de toute chose »
Serait-il possible que la rhétorique ne soit pas si différente de la philosophie ? Et inversement ?
Ne peut-on voir en ocrate la figure d’un philosophe sophiste, habile en discours et utilisant une dialectique qui n'est autre qu'une méthode rhétorique fondée sur la logique. Dialectique comme méthode ontologiquement valable : le logos a un rapport à la vérité – outil de découverte ou de critique du mensonge.
La rhétorique et l'art de la parole ont en effet, même chez Platon, une valeur de vérité, une valeur cognitive. C'est par la Dialectique, par le dialogue et la logique que l'on rattache et casse les êtres en fonction de leur genre et de leur espève. Aristote, disciple de Platon et membre de l'Académie, reprendra cette méthode qui fait du langage un outil de réflexion et de découverte de la vérité : Aristote, Rhétorique (Ive siècle av. JC).
c. La parole et ses effets de vérité
Revenons-en au premier extrait du Gorgias : la rhétorique est un sport de combat !
Ce que reproche Platon à l'art des Sophistes, c'est que dans son exerrcice, ce qui est important c'est de convaincre, de persuader : tous les moyens sont bons. La parole n’est pas le lieu de la vérité pour Platon. Il faut sans doute relier cette conception platonicienne à l’idée antique selon laquelle la connaissance humaine est vanité : seuls les dieux connaissent vraiment (c'est ce que souligne Pierre Vespérini dans son ouvrage sur La philosophie antique).
De même, les philosophes et les sophistes ont une conception différente de la vérité : vérité révélée, intuition (Socrate) contre vérité établie en commun ! La vérité n’est pas reliée au savoir pour les Sophistes, mais à la puissance. La parole ne produit pas seulement des images, elle a des effets concrets par la conviction, elle détermine des actions. C'est le sens de la rhétorique romaine : il ne s’agit plus de chercher un sens et une manière de vivre, mais bien de se convaincre, de se motiver à agir politiquement, mais aussi comme maître de sa maison et de soi… La parole est à mettre en relation avec l'action, mais aussi avec l'autorité.
2. Autorité de la parole : la parole, un outil de pouvoir ou de domination ou une condition de la liberté ?
Politique et langage / La parole est une force et non un simple outil : force politique, force de gouvernement de soi et des autres
La parole est pour les sophistes clairement un outil de pouvoir et de gouvernement des autres : par la force de la conviction (qui utilise aussi bien démonstration, appel aux passions, rappel de la tradition, des exemples et des textes), elle vise à emporter l’adhésion.
Mais d’un autre point de vue, la parole est ce qui permet de contester les a priori, les jugements hâtifs, de se défendre dans un procès : de triompher de la tyrannie.
Avant de saisir les pouvoirs de la parole, il nous faut comprendre les sources de cette autorité, de sa légitimité
a. Sources de l'autorité ?
Mythe (autorité religieuse) / Tradition (exemples, hommes célèbres, mœurs) / Nature ou Loi (en tant qu’elle est extérieure à la société / Connaissance (autorité du sage qui sait) / Raison (logique et raisonnement) / Démocratie (autorité de la majorité ?)
Autorité renversée du monde moderne -------- la nouveauté fait autorité
Il semble déjà bien que l’autorité de la parole soit à la fois une conséquence et une cause de la cohésion des sociétés – la parole tire son autorité de répéter ce qui fait la cohésion, par la parole la cohésion se redouble et s’affirme…
Pierre Clastres, La société contre l’état
« Parler, c'est avant tout détenir le pouvoir de parler.
Ou bien encore, l'exercice du pouvoir assure la domination de la parole : seuls les maîtres peuvent parler. Quant aux sujets : commis au silence du respect, de la vénération ou de la terreur. Parole et pouvoir entretiennent des rapports tels que le désir de l'un se réalise dans la conquête de l'autre. Prince, despote ou chef d'État, l'homme de pouvoir est toujours non seulement l'homme qui parle, mais la seule source de parole légitime : parole appauvrie, parole pauvre certes, mais riche d'efficience, car elle a nom commandement et ne veut que l'obéissance de l'exécutant.
Extrêmes inertes chacun pour soi, pouvoir et parole ne subsistent que l'un dans l'autre, chacun d'eux est substance de l'autre et la permanence de leur couple, si elle parait transcender l'Histoire, en nourrit néanmoins le mouvement : il y a événement historique lorsque, aboli ce qui les sépare et donc les voue à l'inexistence, pouvoir et parole s'établissent dans l'acte même de leur rencontre. Toute prise de pouvoir est aussi un gain de parole. »
b. La parole comme phénomène social
« Ce que parler veut dire » : une approche sociologique du langage
LIBÉRATION. – Ce qui m’a frappé dans votre livre c’est qu’en fait, il est traversé d’un bout à l’autre par la question du pouvoir et de la domination.
PIERRE BOURDIEU. – Le discours quel qu’il soit, est le produit de la rencontre entre un habitus linguistique, c’est-à-dire une compétence inséparablement technique et sociale (à la fois la capacité de parler et la capacité de parler d’une certaine manière, socialement marquée) et d’un marché, c’est-à-dire le système de « règles » de formation des prix qui vont contribuer à orienter par avance la production linguistique. Cela vaut pour le bavardage avec des amis, pour le discours soutenu des occasions officielles, ou pour l’écriture philosophique comme j’ai essayé de le montrer à propos de Heidegger. Or, tous ces rapports de communication sont aussi des rapports de pouvoir et il y a toujours eu, sur le marché linguistique, des monopoles, qu’il s’agisse de langues secrètes en passant par les langues savantes.
[…]
LIBÉRATION. –Vous considérez donc que le langage devrait être au centre de toute analyse politique ?
P.B. – Là encore, il faut se garder des alternatives ordinaires. Ou bien on parle du langage comme s’il n’avait d’autres fonction que de communiquer ; ou bien on se met à chercher dans les mots, le principe du pouvoir qui s’exerce, en certains cas, à travers eux (je pense par exemple aux ordres ou aux mots d’ordres). En fait les mots exercent un pouvoir typiquement magique : ils font croire, ils font agir. Mais, comme dans le cas de la magie, il faut se demander où réside le principe de cette action ; ou plus exactement quelles sont les conditions sociales qui rendent possible l’efficacité magique des mots. Le pouvoir des mots ne s’exerce que sur ceux qui ont été disposés à les entendre et à les écouter, bref à les croire. En béarnais, obéir se dit crede, qui veut dire aussi croire. C’est toute la prime éducation – au sens large - qui dépose en chacun les ressorts que les mots (une bulle du pape, un mot d’ordre du parti, un propos de psychanalyste, etc.) pourront, un jour ou l’autre, déclencher. Le principe du pouvoir des mots réside dans la complicité qui s’établit, au travers des mots, entre un corps social incarné dans un corps biologique, celui du porte-parole, et des corps biologiques socialement façonnés à reconnaître ses ordres, mais aussi ses exhortations, ses insinuations ou ses injonctions, et qui sont les « sujets parlés », les fidèles, les croyants. C’est tout ce qu’évoque, si on y songe, la notion d’esprit de corps : formule sociologiquement fascinante, et terrifiante.
LIBÉRATION. – Mais il y a pourtant bien des effets et une efficacité propres du langage ?
P.B. – Il est en effet étonnant que ceux qui n’ont cessé de parler de la langue et de la parole, ou même de la « force illocutionnaire » de la parole, n’aient jamais posé la question du porte-parole. Si le travail politique est, pour l’essentiel, un travail sur les mots, c’est que les mots contribuent à faire le monde social. Il suffit de penser aux innombrables circonlocutions, périphrases ou euphémismes qui ont été inventés, tout au long de la guerre d’Algérie, dans le souci d’éviter d’accorder la reconnaissance qui est impliquée dans le fait d’appeler les choses par leur nom au lieu de les dénier par l’euphémisme. En politique, rien n’est plus réaliste que les querelles de mots. Mettre un mot pour un autre, c’est changer la vision du monde social, et par là, contribuer à le transformer. »
Pierre Bourdieu, entretien avec Didier Eribon - Libération (19 octobre 1982)
c. Résister à l’autorité
Expérience de Milgram - https://youtu.be/6w_nlgekIzw
Difficultés pour résister à l’autorité : champ social
Autorité scientifique, autorité politique, autorité aussi du « jeu » social
3. Séduction de la parole : vérité et mensonge
Les paroles sont comme des images que l’on peut conserver : « Les paroles gelées » Rabelais Quart Livre
La parole séduit par différents moyens dont nous avons parlé ------- elle est en elle-même séduisante : le mot lui-même, le son lui-même
La parole fait éprouver des sensations, des sentiments
Ut pictura poesis
a. Les manières de séduire
• Mais la séduction par la parole n'est pas seulement le propre des rhéteurs, c'est aussi bien sûr celui des poètes, d'hier à aujourd'hui, dont la parole charme celui qui les écoute ou les lit.
Le Banquet de Platon
Différentes séductions qui proviennent de la parole
Agathon – le poète tragique
Outre les poètes antiques, que nous lisons toujours (Homère, Virgile, etc.), une figure mythique se détache lorsqu'on évoque la poésie des origines : Orphée. Selon la légende, Apollon lui aurait fait don d'une lyre, et les muses lui auraient appris à en jouer. Orphée devient ainsi capable de charmer les animaux, mais aussi les arbres et les rochers. Il participe d'ailleurs à l'expédition des Argonautes, et son chant parvient à charmer le serpent gardien de la Toison d'or. Lorsque son épouse Eurydice, voulant échapper aux avances d'un dieu, est mordue par un serpent et meurt, Orphée est inconsolable : il se rend à l'entrée des Enfers et, grâce à son chant et à sa musique, réussit à attendrir Charon, le passeur, mais aussi le chien Cerbère, et même Hadès. Ce dernier permet à Orphée de ramener Eurydice à la vie, à une condition : il ne doit pas se retourner vers sa femme avant d'avoir revu la lumière du jour. Mais Orphée ne parvient pas à respecter cette condition : juste avant d'arriver à la lumière, il se retourne, et perd définitivement Eurydice. Orphée donne ainsi de la figure du poète une image double : il est celui qui reçoit un don et qui est proche des dieux, en même temps qu'il est profondément homme. Il permet également de mettre l'accent sur une fonction fondamentale du poète : celle de l'enchanteur, grâce à la puissance du lyrisme et aux liens qui unissent poésie et musique (remarquons que la figure d'Orphée, poète inspiré, a été également inspirante : qu'on pense aux Métamorphoses d'Ovide, à l'opéra de Monteverdi, au film de Cocteau, etc.).
• Plus généralement, on peut dire que la poésie puise sa puissance de séduction dans le fait qu'elle permet une redécouverte de notre langue.
• Lorsqu'un artiste s'empare de la langue pour y trouver des termes rares, lorsqu'il écoute les combinaisons sonores obtenues par l'enchaînement des vers, il offre au lecteur la possibilité de redécouvrir la matérialité des mots.
Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à confondre le mot et la chose et à ne plus « écouter » ni « voir » les mots pour eux-mêmes – même si certaines circonstances font que nous choisirons tel terme plutôt que tel autre, à cause précisément de ses sonorités ou de l'image qu'il évoque pour nous. Le poème est le lieu où l'attention aux termes est portée au paroxysme. Nous nous laissons bercer, ou nous sommes frappés, par une émotion musicale parfois même détachée du sens.
Certains textes nous touchent d'abord par leur forme – avant même que nous ne comprenions tout à fait leur sens. Si l'on pousse cette conception plus loin encore, le thème du poème peut alors n'avoir que peu d'importance. La description d'une scène, d'un objet, ou l'évocation d'un épisode, deviennent ainsi pour le poète des « pré-textes ». Les poètes parnassiens s'inscrivent notamment dans cette conception.
• À partir du xixe siècle, et même si certains poètes avaient déjà exploré cette voie auparavant, la recherche esthétique ne passe plus forcément par la forme fixe. Les romantiques d'abord, puis les symbolistes, revendiquent une liberté créatrice, les poètes assouplissent le vers et se mettent à employer des vers moins fréquents. Ainsi Verlaine écrit-il dans son Art poétique :
• « De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l'Impair »
• Les vers de ce poème comptent neuf syllabes, c'est-à-dire un nombre impair, alors que la tradition allait plutôt vers les mètres pairs. À partir de cette époque, la perfection formelle ne passe plus par l'observation de cadres déjà créés, mais au contraire par l'ouverture sur un langage neuf.
Mallarmé, lui, souhaite « redonner un sens plus pur aux mots de la tribu » : il cherche un langage originel, redonne aux mots leur sens étymologique (le plus souvent oublié), il mêle les différents sens d'un mot polysémique, etc. L'objectif de tels poètes n'est plus seulement d'orner la pensée selon des codes préétablis, il est de déployer toutes les richesses d'une langue et ainsi d'accéder à des sens multiples afin de donner un pouvoir de séduction à la parole qui devient ainsi une sorte de musique qui touche l'âme de celui qui l'écoute.
b. Les mots et les sons
Les sons ont en eux-mêmes séduisants
Séduction et flatterie
La séduction est un terme provenant du verbe latin seducere signifiant « amener à part, amener à l'écart ». Les séductions de la parole désignent donc essentiellement la puissance par laquelle la parole parvient à nous ensorceler, à nous charmer, voire à nous détourner de ce que l'on pensait ou faisait avant de l'entendre. A nous faire aimer, nous faire éprouver des sensations agréables…
Si nous en revenons à la rhétorique, nous voyons bien que cette fonction de la parole est utilisée par les sophistes pour convaincre, pour embarquer l’auditoire et emporter les avis, les opinions.
• Le sophiste grec Gorgias a particulièrement exposé la puissance de la parole capable de produire des effets sur les hommes en les touchant sur le plan affectif et émotionnel. Voici un extrait de l'Éloge d'Hélène de Gorgias :
« […] En second lieu, considérons les plaidoyers judiciaires qui produisent leur effet de contrainte grâce aux paroles : c'est un genre dans lequel un seul discours peut tenir sous le charme et persuader une foule nombreuse, même s'il ne dit pas la vérité, pourvu qu'il ait été écrit avec art. En troisième lieu, considérons les discussions philosophiques : c'est un genre de discours dans lequel la vivacité de la pensée se montre capable de produire des retournements dans ce que croit l'opinion. » (Gorgias de Léontium, Éloge d'Hélène)
Cette éloquence au service de l'argumentation n'est pas sans danger, et peut devenir une manipulation dans la mesure où son objectif n'est pas la vérité, mais seulement la vraisemblance (l'interlocuteur adhère à ce qui lui semble être vrai).
Publicité, propagande, discours politique… sont autant de formes qui utilisent les ressorts de la persuasion et qu'il faut appréhender en connaissance de cause, sans jamais se départir de son esprit critique.
Gorgias le souligne ainsi :
« 14. Il existe une analogie entre la puissance du discours à l'égard de l'ordonnance de l'âme et l'ordonnance des drogues à l'égard de la nature des corps. De même que certaines drogues évacuent certaines humeurs, et d'autres drogues, d'autres humeurs, que les unes font cesser la maladie, les autres la vie, de même il y a des discours qui affligent, d'autres qui enhardissent leurs auditeurs, et d'autres qui, avec l'aide maligne de Persuasion, mettent l'âme dans la dépendance de leur drogue et de leur magie. » (Gorgias de Léontium. Éloge d'Hélène)
Texte 10. Épisode des Paroles dégelées dans le Quart Livre de Rabelais
c. Le dialogue amoureux
Le discours amoureux est performatif : en lui-même il est séducteur, il constitue la relation qu’il veut appuyer. Le caractère performatif de la parole, tel que le souligne John Austin dans son ouvrage "Quand dire, c'est faire" en 1955, consiste dans le fait qu'une parole peut être en même temps un acte, par exemple un engagement ou une promesse (exemple du maire qui en prononçant la formule consacrée "Je vous fais mari et femme" réalise un mariage).
Ainsi nous devons relever que la Séduction de la parole n'est pas purement esthétique ou psychologique, elle est en elle-même un acte de séduction. Ainsi du discours amoureux et érotique qui séduit en égarant ("seducere" en latin = "égarer", "détourner du droit chemin"), mais qui est elle-même une parole détournée de toute finalité extérieure : une parole poétique. Art d’engager une relation amoureuse, le dialogue, le discours quand il est écouté est déjà une relation amoureuse. Il permet sans doute de surmonter ce paradoxe de l'amour souligné par Jean-Paul Sartre : dans l'amour, je veux que l'autre m'aime librement, mais que librement il devienne esclave de son amour à chaque instant. Le discours amoureux est le lieu d'une relation amoureuse, il est cet espace de langage qui capte, réunit et enchaîne deux libertés : celle de l'auditeur et celle de celui qui parle.
Comme le montre Roland Barthes, dans Fragment d’un discours amoureux, il y a un caractère matériel et physique du mot – le mot engage le corps et le discours amoureux est relation érotique. Jeu avec le désir, susciter le désir et le mettre à distance, le retenir, en repousser la satisfaction.
Entretien : être en relation, entretenir la relation, prendre soin – éthique du care – prendre soin, sollicitude, reconnaissance d’autrui
Inséparable de la parole
La parole est ce qui nous met en relation avec l’autre et le monde et ce qui entretient et fait vivre cette relation – relation de conviction, relation amoureuse, relation d’attention à l’autre
Conclusion
Parole qui est le propre de l’homme – le distingue des autres êtres vivants et manifeste son caractère à la fois rationnel et social
Arts de la parole – esthétique
Rhétorique : art de bien parler – art à la fois utile dans ses effets et inutile dans son raffinement – rapport à la vérité et à la conviction
Effets politiques – la parole est un phénomène social – Ainsi les registres de langue s’enracinent dans les hiérarchies et les rôles sociaux – ils sont l’écho de l’organisation sociale et par l’effet d’autorité, en reconduisent la hiérarchie
Enfin, la parole est aussi un phénomène éthique qui concerne l’engagement de chacun. Dans la recherche de la vérité : par le recours à la démonstration rationnelle, mais aussi par le recours au dialogue avec autrui pour établir ensemble une vérité commune.
Nous avons souligné que la parole était la concrétisation des relations humaines et finalement ce qui nous relie et nous maintient ensemble – maintient notre intérêt les uns pour les autres, notre amour ou notre amitié pour autrui – nous installe dans des rapports éthiques de sollicitude et de soin et de séduction qui font que nous nous préoccupons toujours de l’opinion, de l’avis des autres hommes et que notre engagement dans la vie sociale et dans la vie éthique passe toujours par la parole.
Ajouter un commentaire