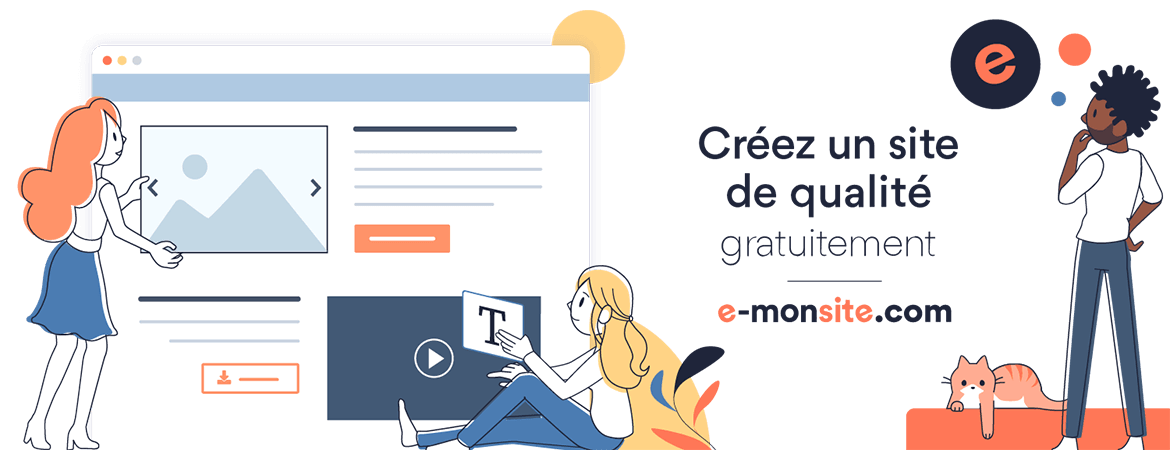- Accueil
- Lectures suivies
- Platon - L'Alcibiade
Platon - L'Alcibiade
L’Alcibiade de Platon
I- Présentation générale
Biographie de Platon (428 - 348 av. JC)
Né dans la grande aristocratie athénienne, Platon semble promis dans ses jeunes années à une carrière. Comme c’était d’usage dans l’aristocratie grecque, il étudie les mathématiques, la musique et la gymnastique.
Sa rencontre avec Socrate, en 408, est décisive et l'amène à renoncer aux arts pour s'adonner à la philosophie. Alors que Socrate refusait d’écrire et pratiquait une philosophie orale sur la place publique, Platon va transcrire son enseignement et sera ainsi considéré comme le premier des philosophes. La condamnation à mort de Socrate par les Athéniens en -399 marquera durablement son disciple, Platon se fera le dépositaire de l’enseignement de Socrate.
Platon sera le fondateur de l’Académie à Athènes (en -387), une école philosophique où l’on enseigne la philosophie, mais aussi les mathématiques et la gymnastique. L’importance des mathématiques feront qu’au fronton de l’Académie, à l’entrée du jardin d’Academus, soit inscrit : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». Cela révèle un aspect de la théorie platonicienne qui voit dans les Nombres et les mathématiques le domaine de la Vérité et de l’Universalité, au contraire des domaines du sensible où toute chose passe et se transforme. L’enseignement y est prodigué sous forme de discussions, de débats et Platon privilégie dans ses écrits cette forme dialoguée.
Parmi les élèves de Platon se distingue particulièrement Aristote qui fondera en son temps une nouvelle école de Philosophie, le Lycée.
L’œuvre de Platon est constituée de dialogues qui mettent en scène Socrate son maître (à l’exception de sa dernière œuvre Des Lois). Parmi ses dialogues les plus connus on peut distinguer l’Alcibiade (sans doute une des premières œuvres), le Protagoras (qui présente une réponse à l’enseignement des sophistes), l’Apologie de Socrate et le Criton (récit du procès et de la condamnation de Socrate), Le Banquet (dialogue qui porte notamment sur l’Amour et qui voit Alcibiade faire un portrait ému et émouvant de Socrate), ou encore La République (dialogue qui traite de régime politique le plus juste : selon Platon, le gouvernement des philosophes)…
Présentation des personnages
Socrate (469-399 av. JC)
Socrate est un des premiers philosophes historiques, bien que certains aient professé avant lui l’amour de la sagesse (les Présocratiques), il est le premier à se détacher à la fois de l’opinion et du mythe pour rechercher une vérité que l’on puisse justifier par la raison.
Socrate est issu d’une famille modeste, son père est sculpteur et sa mère « maïeuticienne », c’est-à-dire « sage-femme ». On représente toujours Socrate discutant, vêtu d’un manteau grossier, parcourant les rues pieds nus, par tous les temps. Il a une apparence vulgaire et est très laid. Pour les grecs, l’apparence physique reflétait la qualité morale, il constitue donc en lui-même un scandale.
Il se réclame du métier de sa mère pour qualifier sa propre méthode pour « accoucher les esprits », c’est-à-dire pour faire découvrir par eux-mêmes à ses interlocuteurs des savoirs dont ils n’avaient pas conscience. La méthode maïeutique est une philosophie du dialogue qui conduit grâce à l’échange d’idées sur le chemin de vérités rationnelles. Il ne quitte jamais Athènes et passe son temps à interpeller les jeunes gens, notamment ceux issus de bonnes familles, pour les provoquer au jeu des questions-réponses. Socrate sera d’ailleurs accusé, au cours de son procès, de détourner les jeunes gens de la vie politique, de corrompre la jeunesse.
Donc, cet homme déjà âgé, laid et d’extraction modeste, se permet d’accoster tout un chacun sur la place publique pour lui poser des questions concernant les problèmes moraux, la Justice ou le Courage… Mais, de plus, la méthode socratique passe d’abord par l’ironie (nous le verrons aussi dans l’Alcibiade). Il commence par prouver à son interlocuteur, qui souvent se croit très savant, qu’il ne sait rien, qu’il n’est qu’un ignorant qui s’ignore. Cette ironie est évidemment un autre aspect du scandale que constitue l’effort philosophique de Socrate : lui-même affirme qu’il ne sait qu’une chose, c’est qu’il ne sait rien…
Le caractère dérangeant de Socrate lui attirera l’inimitié des puissants qui lanceront des accusations contre lui. Il sera ainsi accusé de ne pas honorer les dieux et de corrompre la jeunesse. Platon relate sa plaidoirie au cours de laquelle Socrate démontrera l’absurdité de son procès et refusera de se plier aux exigences des juges (arrêter de philosopher avec ses concitoyens), allant jusqu’à proposer d’être récompensé pour le bien qu’il dispense… Condamné, il refusera l’exil et se donnera la mort en s’empoisonnant avec de la ciguë. Le procès et la condamnation de Socrate marqueront ses disciples, dont Platon qui restera toujours méfiant à l’égard de la démocratie. Ce procès du philosophe peut aussi être rapporté à l’histoire de la philosophie comme celle d’une lutte pour la liberté de s’exprimer et de réfléchir sur la place publique, contre les pouvoirs, l’opinion et les croyances.
Socrate n’a jamais écrit, nous connaissons son enseignement par le témoignage d’autres philosophes et, en premier lieu, de Platon qui fut son disciple. Platon écrit de nombreux dialogues qui mettent en scène son maître et qui rendent compte de sa méthode et de son enseignement. Pourtant, il est difficile de départager aujourd’hui ce qui fait partie de l’enseignement de Socrate de la doctrine élaborée par Platon lui-même. Les premiers dialogues (dont l’Alcibiade) sont néanmoins généralement considérés comme représentatifs de la pensée et de la méthode socratique.
Alcibiade (450-404 av. JC)
Alcibiade est un personnage historique ayant joué un rôle important dans les dernières heures de la démocratie athénienne. En effet, fils de Clinias, né en 450 et mor en 404 av. JC, Alcibiade est aussi le neveu de Périclès (Stratège athénien qui guidera le destin de la Cité grecque durant son âge d’Or et qui établira notamment nombre de lois de la démocratie athénienne) qui deviendra son tuteur. Alcibiade est donc un des plus riches héritiers d’Athènes, il fait partie de cette « jeunesse dorée » qui déclenchait l’admiration des foules. De plus, Alcibiade possède tous les dons, il est beau et remporte de nombreuses épreuves olympiques, mais il est aussi intelligent et possède l’art de convaincre par le discours, il maîtrise la rhétorique si utile en politique lors des assemblées et des délibérations. En réalité, de nombreux écrivains ou philosophes considéreront qu’il représente à lui seul les qualités et les défauts d’Athènes.
En effet, Alcibiade s’il est adoré par ses contemporains, est aussi remarqué par son arrogance et sa prétention, il est un personnage d’excès et de jeunesse et il ne représente pas la sagesse et la tempérance que tentera de lui inculquer Socrate. La relation amoureuse entre Alcibiade et Socrate, qui ont été compagnons d’arme et se sont portés secours l’un l’autre, est attestée par la plupart des auteurs. Mais elle symbolise aussi la relation de Socrate et de la philosophie avec la jeunesse athénienne qu’elle tente en vain de convertir à l’amour de la sagesse et à la tempérance.
Vers 420, il commence une carrière politique comme démocrate et sera élu stratège. Mais il s’oppose dès le début à Nicias, qui a signé la paix avec Sparte. Nous sommes au milieu de la guerre du Péloponnèse qui opposera Athènes, alors en démocratie, à Sparte qui prône l’oligarchie. Cette guerre s’étendra de 431 à 404 et verra la défaite d’Athènes et la fin de l’impérialisme athénien face donc à ses deux ennemis que sont les Lacédémoniens et les Perses. L’entrée en politique d’Alcibiade se situe à un moment de paix entre les cités, mais ce moment ne sera qu’une parenthèse dans les guerres pour l’hégémonie sur la monde grec. Alcibiade, jeune et avide de gloire, est bien sûr un partisan de la guerre et ses interventions à l’Assemblée précipiteront de nouvelles expéditions de conquête.
Le personnage historique Alcibiade est particulièrement paradoxal. Adulé à Athènes, il est un moment élu Stratège et est à l’initiative d’expéditions guerrières. Animé par son désir de réussite politique et de gloire, Alcibiade précipitera la chute d’Athènes. Suite aux échecs rencontrés dans ses conquêtes (aventure sicilienne) et à sa condamnation par les Athéniens, il n’hésitera pas à changer de camp et à rejoindre Sparte. Plus tard, on le retrouve même chez les Perses. Pourtant, il se rapprochera à nouveau des Athéniens qui l’accueilleront à nouveau. C’est un personnage complexe qu’il s’agit de comprendre dans son contexte.
Contexte du dialogue
Platon écrit son dialogue en connaissance de cause, quelques années après la défaite, puisqu’il déplore justement cette intempérance qui a conduit les Athéniens à se lancer dans des conquêtes aventureuses et dans des expéditions guerrières qui les ont menés à leur perte. En effet, le personnage historique Alcibiade, dont les liens avec Socrate semblent confirmés, a participé à la chute d’Athènes en conduisant notamment une expédition aventureuse en Sicile qui fragilisera Athènes face à Sparte. Alcibiade représente la jeunesse et les qualités de l’Athènes démocratique, mais aussi son insouciance et ses excès, sa démesure qui s’exprime notamment dans un impérialisme qui lui sera fatal. Le destin d’Alcibiade est une allégorie de la fin de l’Empire athénien.
Ainsi, le dialogue se déroule avant la chute de la démocratie athénienne dans une période de paix fragile durant la guerre de Péloponnèse (431-404) qui oppose Athènes à Sparte et ses alliés. Socrate interpelle Alcibiade, qu’il aime en secret, au moment où celui-ci va se présenter à l’Assemblée (ecclesia) pour y donner son premier discours. C’est donc au jeune Alcibiade qu’il s’adresse, à celui qui est sur le point de se lancer en politique et d’entamer une carrière militaire (Alcibiade sera Général). Mais Socrate ne l’intercepte pas pour l’encourager ou encore le convaincre à propos d’un sujet quelconque : il entend arrêter Alcibiade dans l’élan de ses ambitions et l’amener à réfléchir au sens de son engagement, à ce qui lui donne le droit de prétendre à une position politique et sociale, et enfin à s’interroger sur ses savoirs et sur lui-même.
Propos général du texte
Le dialogue de Platon intitulé Alcibiade fut pendant des siècles présenté aux étudiants comme la meilleure introduction à la doctrine de Platon et de Socrate. Il s’agit d’un des premiers dialogues de Platon, de ceux que l’on regroupe sous le genre maïeutique parce qu’ils présentent avec beaucoup de vraisemblance la méthode socratique et sa façon de conduire les discussions avec ceux qu’il rencontrait.
Le texte est sous-titré par la tradition « Sur la nature de l’homme » et il s’agit en effet principalement de s’interroger sur ce qui est le propre de l’individu, ce qu’il doit connaître pour se connaître lui-même. L’occasion de ce dialogue conduit donc Socrate à interroger Alcibiade sur ses ambitions et sur ce qui lui permet de prétendre entrer en politique, donner son avis et ses conseils aux athéniens.
La première partie situe l’intervention de Socrate dans un contexte à la fois amoureux et mystique, puisque c’est le dieu qui commande à Socrate d’interpeller Alcibiade. Le dialogue une fois engagé, Socrate va évaluer les qualités et les savoirs d’Alcibiade : ils cherchent ensemble ce qui lui permet de prétendre guider la Cité. Il s’agit d’abord de déterminer le savoir spécifique à la politique, ce qu’Alcibiade doit connaître pour conseiller sagement les Athéniens. Alors qu’Alcibiade est obligé de reconnaître qu’il ne possède pas de savoir technique, il pense posséder une connaissance suffisante pour la politique générale. Les interlocuteurs s’accordent à identifier comme principe du politique, la Justice. Or, Alcibiade s’avère incapable de donner une définition satisfaisante de ce qu’est le juste : c’est donc qu’il ignore ce qu’est le juste (qu’ils compareront notamment à l’avantageux).
La seconde partie s’oriente alors vers la question de l’éducation : d’où vient cette connaissance du juste et du bien nécessaire à la politique ? Socrate va montrer que pour s’occuper de la Cité, il faut d’abord « s’occuper de soi » et que pour gouverner en politique, il faut avant tout « se gouverner soi-même ». Le soin et le gouvernement de soi passent selon Socrate par une connaissance de soi, une connaissance de notre âme. Nous sommes passés de la reconnaissance de l’ignorance d’Alcibiade à l’impératif d’une « conversion » de celui-ci à l’étude de lui-même et de son âme, avant que de se mêler de conduire les autres.
Il y a donc successivement dans cette œuvre une distinction entre les savoirs techniques et la sagesse politique (gouvernement des hommes), puis une invitation à l’effort philosophique de se connaître soi-même, enfin une définition de la nature humaine comme celle d’un être composé d’un corps et d’une âme qui « gouverne ».
II. Déroulement du dialogue
a) Plan du texte
Première partie (ironie socratique)
- Introduction du dialogue et proposition de Socrate
- Portrait de l’ambitieux Alcibiade
- Examen des compétences d’Alcibiade
- compétences techniques
- compétences générales
- Que faut-il apprendre pour gouverner la Cité
- Le Juste, l’avantageux
- Difficultés des critères de Justice
Deuxième partie (dialogue maïeutique)
- Améliorer la Cité / S’améliorer soi-même
- Le bon gouvernement repose bien sur une connaissance, celle de la Cité et de la manière de l’améliorer- Pour savoir comment améliorer la Cité, il faut déjà savoir comment s’améliorer soi-même
- Définition de la nature humaine : qu’est-ce qui est spécifique à l’individu et qui le gouverne ?
- L’homme est d’abord une âme et la préoccupation de soi est une préoccupation morale, éthique.
Conclusion
L’amélioration de soi passe par le soin que l’on apporte à son âme et à la pratique de la vertu. Tant qu’Alcibiade n’aura pas acquis plus de sagesse, de tempérance et d’abord de maîtrise et de connaissance de lui-même, il ne sera d’aucune utilité pour la Cité.
b) Détail de l’argumentation
PREMIERE PARTIE
(p.87) [103a] Introduction et Situation
Alcibiade doit « entrer en politique », « monter à la tribune », mais Socrate l’arrête. Il lui avoue son amour désintéressé, mais lui offre aussi de l’aider au mieux afin qu’il se lance dans sa carrière avec tous les atouts nécessaires à sa réussite. Un tel discours ne peut qu’intéresser Alcibiade qui connaît depuis longtemps Socrate et qui l’admire.
Socrate va commencer par un discours d’admiration à l’égard d’Alcibiade dont il loue la beauté, l’athlétisme, l’intelligence, la naissance et la richesse. Mais il va montrer ensuite que ces qualités « naturelles » ou « de naissance » que possède Alcibiade ne sont pas suffisantes, car il lui manque l’éducation. En effet, Alcibiade s’est toujours soustrait à la relation pédagogique et n’a pas eu de maître.
Socrate dévoile l’ambition d’Alcibiade qui est de participer à la vie politique de la cité, mais surtout de se couvrir de gloire, d’être respecté et aimé, d’acquérir du prestige. Alcibiade veut briller et acquérir plus qu’il n’a maintenant, Socrate lui montrera qu’il faut d’abord qu’il s’améliore. Il lui propose donc d’être son maître ou son conseiller.
[106b] Après avoir établi l’ambition d’Alcibiade : donner des conseils aux athéniens, participer aux décisions et devenir « tout puissant » à l’exemple de Périclès, Socrate lui propose de faire un bilan des connaissances qu’il possède et des savoirs qui vont lui permettre de conseiller les autres. Pour cela, il lui demande de bien vouloir établir un dialogue à sa façon, c’est-à-dire d’être interrogé par Socrate et de devoir répondre, plutôt que d’écouter simplement un discours rhétorique à la manière des Sophistes.
(p. 91) [106c] Examen des compétences d’Alcibiade
Dans quels cas, le jeune Alcibiade pourrait-il conseiller les Athéniens ? Concernant les sujets qu’il connaît bien sûr mieux qu’eux. Mais alors, quels sont ces sujets lui demande Socrate. Ils vont ainsi passer en revue les différentes compétences qui correspondent aux savoirs techniques : il se révèle rapidement qu’Alcibiade ne possède aucune compétence de cette sorte qui le destinerait à conseiller les Athéniens. Il est cependant obligé de concéder à Socrate que ce n’est pas sa naissance ou sa richesse qui lui permettront d’être le meilleur conseiller.
[107d] Pourtant, celui-ci ne s’avoue pas encore vaincu et va tenter de défendre l’idée selon laquelle il a une connaissance de ce qui concerne les affaires générales de la cité, c’est-à-dire de ce qui est convenable de faire et ce qu’il est « mieux » de faire. Ainsi, il se situe d’emblée dans le moment décisif du choix pour ou contre la guerre. La question se ramène finalement, comme le montre Socrate, à ce qu’il est juste ou non de faire (le « meilleur » est ce qui est le plus « juste »).
(p.102) [109b] Qu’est-ce qui est juste ?
Pourtant, Socrate lui montre rapidement qu’il est incapable de définir avec précision ou simplement avec constance cette justice dont il se réclame. D’ailleurs, Socrate fait admettre à son interlocuteur qu’il ne peut se référer à aucun maître en la matière et que, s’il semble qu’il ait acquis le sens de la Justice seul, il est néanmoins incapable de dire à quel moment [109d]. Au passage, Socrate lui fait admettre qu’il n’y a que deux façons de connaître quelque chose : soit nous l’avons appris de quelqu’un, soit nous l’avons découvert par nous-même.
Mais alors comment bien juger ? Comment décider de ce qui est mieux pour la Cité si l’on est incapable d’établir des critères et de donner des définitions exactes de la Justice, du meilleur ? C’est la question de l’amélioration que soulève ici Socrate. Comment améliorer la Cité ?
Faudrait-il s’en remettre à l’avis du plus grand nombre sur ces questions ? [110e] Socrate montre rapidement que l’opinion est justement sur ces questions très variable, les grecs se déchirent sur ces questions et personne n’est d’accord. Il faut pourtant admettre qu’il est nécessaire de posséder la connaissance du juste et du convenable pour diriger la Cité. Selon Socrate, ce qui distingue une opinion mal assurée d’un savoir est justement le fait que l’opinion varie sur le sujet et que les hommes soient incapables de se mettre d’accord. Il n’y a pas de critère de Justice à chercher du côté de la multitude, de l’opinion de la majorité : ne serait-ce pas déjà une attaque en règle contre le principe démocratique ? Si donc Alcibiade est incapable de définir le juste, d’indiquer celui qui lui a appris ce qu’était la Justice et à quel moment il l’a appris, c’est qu’il ne peut être sûr de son savoir ! Alcibiade projette donc « une entreprise déraisonnable », celle d’enseigner ce qu’il ne connaît pas, « ayant négligé de l’apprendre » [113c]
Mais Alcibiade ne se laisse pas ici désarçonner aussi facilement. Il objecte à Socrate que si les Athéniens et lui-même ne perdent pas leur temps à s’interroger sur la Justice, c’est qu’il n’est pas nécessaire de l’apprendre, puisqu’elle est une évidence [113d]. Selon lui, il faut laisser de côté ces évidences et décider en fonction d’un autre critère, celui de l’avantageux ! Mais Socrate lui reproche alors de reprendre la discussion au début : il pourrait fort bien lui faire la même démonstration qu’auparavant pour lui prouver qu’il ne sait pas réellement ce qu’est l’avantageux… Mais pour le bien d’Alcibiade, Socrate va accepter de poursuive et lui prouver que, contrairement à ce que soutient Alcibiade, le Juste et l’avantageux sont une seule et même chose. Il le questionne donc sur les termes de beau, bon, avantageux et juste, pour finalement lui faire avouer qu’ils désignent toujours la même chose, qu’ils sont identiques en ce qui concerne le comportement individuel (exemple du courage), mais aussi sans doute le gouvernement de la Cité [116e].
Socrate a donc fait avouer à Alcibiade que son opinion variait quant à la définition du Juste : or, Socrate démontre par l’exemple que cette inconstance de l’opinion est synonyme d’ignorance, et même de double ignorance (Alcibiade croit savoir) [118b]. Pour le moins, Socrate estime que l’on a avancé quand on a identifié une fausse connaissance, une illusion de savoir : seuls ceux qui croient savoir alors qu’ils ne savent pas risquent de se tromper. Quel service il a déjà rendu là à Alcibiade qui se sent plutôt honteux ! L’ironie socratique a fonctionné et l’interlocuteur est prêt à remettre en cause ses opinions pour se mettre à l’école de la philosophie.
DEUXIEME PARTIE
(p.135) [118c] Comment s’améliorer et améliorer la Cité ?
Donc, nous avons établi que le critère du savoir est la connaissance ferme et assurée (et non variable) et l’accord de ceux qui savent entre eux. Or, la Justice est précisément le domaine jusqu’à présent de l’opinion et de son inconstance ! Quel chemin emprunter alors pour accéder à cette connaissance nécessaire ?
Socrate relève que, parmi les hommes politiques d’Athènes, nombreux sont ceux qui ont négligé de s’éduquer avant de se lancer en politique. Il insiste sur l’importance de l’éducation qui constituera le propos de tout le passage. Le philosophe entreprend de démontrer que même Périclès, d’abord présenté comme l’exception, ne doit pas être si savant, puisqu’il n’a su éduquer ses proches. Il s’agit d’une seconde attaque contre la démocratie athénienne. Périclès est en effet le dirigeant qui a favorisé la démocratie athénienne qu’il a guidé durant l’âge d’or de la Cité, entre les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse (on parle du « siècle de Périclès »). Il contribua au rayonnement d’Athènes au niveau des Arts et le Culture avec la construction d’édifices prestigieux (dont le Parthénon et d’autres édifices de l’Acropole), mais aussi à son expansion impériale.
Les compétences du jeune Alcibiade sont à ce moment du dialogue réduites à néant et ses prétentions à gouverner apparaissent bien présomptueuses. D’autant que, comme le souligne à dessein Socrate, il ne peut s’autoriser de sa naissance ou de ses richesses pour s’imposer à ses ennemis, puisque les ennemis de la Grèce ne sont pas moins prestigieux que lui. Ainsi se justifie le passage qui fait l’éloge des Perses et des Spartiates [120e].
(p. 145) [124b] « Connais-toi toi-même »
Quelles sont donc les qualités qui pourraient nous faire surpasser les Perses ou les Spartiates se demandent Socrate et Alcibiade ? Puisqu’il ne s’agit ni de beauté, de naissance ou de richesse, il faut l’emporter par ce que Socrate nomme le soin et la technique, c’est-à-dire par la connaissance technique et l’application de ces techniques à la guerre et à la domination, mais aussi au soin que l’on apporte à son éducation. Les interlocuteurs s’accordent sur l’importance de s’améliorer soi-même pour dominer ses ennemis et se faire un nom chez ses amis, pour être un chef guerrier et un personnage politique. Socrate lie fortement l’impératif d’une amélioration de soi par le soin que l’on apporte à notre propre amélioration et le précepte delphique du « Connais-toi toi-même ».
L’inscription sur le temple de Delphes où la Pythie dispense ses oracles était très connue dans le monde grec et Platon/Socrate propose ici de l’interpréter comme une invitation pour chaque individu. On peut sans doute parler déjà de la constitution de l’individu en « sujet » (le sujet n’est pas un thème antique, mais ici nous pouvons parler avec Socrate du « soi » répété dans toute cette seconde partie), mais surtout, nous le verrons par la suite, en sujet éthique. C’est un impératif éthique selon le texte.
La logique socratique consiste à avancer que pour s’améliorer, il faut prendre soin de soi, mais pour prendre soin de soi, il faut nécessairement ses connaître soi-même. Il s’agit ici de comprendre ce que l’on doit améliorer en soi, quelle est la partie la plus importante à rendre « meilleure » en celui qui veut être maître de lui-même et gouverner les autres.
Pour connaître ce dont il faut prendre soin, Socrate va montrer qu’il est d’abord nécessaire de « distinguer l’essentiel de l’accessoire », ou plutôt de trouver ce qui est le propre de l’homme. Cette partie du texte est donc placée sous le signe de la connaissance de la nature humaine.
(p. 152) Définition de la science politique
Le dialogue permet de préciser ce dont il s’agit pour Alcibiade : il souhaite accéder à la technique lui permettant de gouverner « des hommes qui ont en partage une même constitution et qui se réunissent avec les autres ; voilà ceux auxquels il s’agit de commander dans la cité » [125d]. Quelle est la science qui permettrait de réussir cela ? Quel sont son objet et sa technique propres ? S’ils admettent tous deux l’obligation de l’excellence dans cette science : la science politique, ils ne parviennent pas à la définir précisément ! Son but est bien sûr l’excellence de la Cité, l’amélioration notamment morale de celle-ci. Pour ce faire, il faut sans doute favoriser l’accord et l’amitié entre les citoyens, mais de quelle façon ? A ce moment du dialogue, la réponse n’est pas évidente [127e]! Elle ne sera pas complétée dans l’Alcibiade et il faudra attendre La République de Platon pour que l’on établisse les règles de la constitution d’une Cité meilleure grâce à la politique…
Les interlocuteurs n’ont pas réussi à obtenir une définition satisfaisante de la science politique. Pourtant, ils ont établi une fois pour toute l’importance de connaître l’objet de cette science pour l’exercer efficacement. Toute science a ainsi un objet spécifique ! Qu’en est-il de la science de l’amélioration de soi ? C’est par ce biais que Socrate relancera la discussion qui avait abouti à un constat d’échec…
Le dialogue développe alors l’analogie entre l’amélioration de la Cité et l’amélioration de soi : c’est d’ailleurs plus qu’une analogie contextuelle, puisqu’en réalité il est nécessaire de se maîtriser (technique de gouvernement de soi) et de se connaître pour gouverner la Cité !
(p. 161) Qu’est-ce qui est propre à soi ? Quel est le propre de l’homme ?
Socrate va distinguer différentes genres d’objets dont la technique peut s’occuper : les choses que l’on utilise, celles qui nous appartiennent et celles qui nous définissent ou nous constituent. Il invite, au cours d’un long échange qui pousse la recherche, à distinguer ce qui nous est extérieur et qui peut être à nous, nous être utile, qui sera l’objet d’une technique spécifique ; de ce qui fait partie de nous, le corps, qui est l’objet d’une autre technique. Pourtant, il faut d’abord et toujours savoir ce que nous sommes nous-mêmes, ce qui est sans doute la question la plus difficile [129a]. Il faut impérativement découvrir ce qu’est ce « soi-même lui-même » [129b] pour établir un savoir nous permettant de prendre soin de cet objet : comme il est nécessaire de connaître le corps pour en prendre soin, ou de connaître les techniques de la cordonnerie pour prendre soin des chaussures (ce qui se rapporte à nos pieds). Il y a donc une hiérarchie entre les techniques qui concernent les objets extérieurs et celle qui concerne l’homme lui-même.
Mais pour le moment, nous n’avons pas encore défini ce qui caractérise l’homme : serait-ce son corps ? Nous avons vu que celui qui s’occupe du corps est le gymnaste, prendre soin de soi ce n’est donc pas prendre soin de son corps. On peut laisser à d’autres ces soins extérieurs ou corporels, qu’il ne s’agit cependant pas de négliger. Mais nous cherchons ce dont il faut s’occuper quand on veut s’améliorer soi-même : ce n’est que ce soin de ce qui est le propre de l’individu qui ne doit pas être délégué, mais dont il faut absolument s’occuper soi-même.
Socrate prend alors à nouveau un biais ici : il introduit une considération sur le dialogue, que nous retrouverons plus tard. Quand on est en situation de dialogue, on s’adresse bien à une personne, un « sujet », « à toi et à moi » nous dit Socrate, mais le dialogue lui-même n’est qu’un moyen de communication. Le dialogue est un « outil de communication », pas n’importe lequel puisque nous verrons qu’il permet justement l’échange entre deux individus, entre deux « âmes ». Il faut donc parler des outils que l’on utilise selon une technique, ce qui sert l’homme tout en en étant distinct. Ce qui me sert n’est pas moi, ce dont je me sers n’est pas moi [129c] ! Or l’homme se sert de ses mains, le cordonnier de ses yeux, l’homme de son corps… donc l’homme est différent de son corps » [129e]. Il s’agit ici d’un raisonnement par syllogisme.
(p. 173) La nature humaine est ainsi définie comme étant non pas son corps, ni l’union de son corps et de son âme, mais bien son âme uniquement ! C’est l’homme qui se sert de son corps, ils faut donc retrancher à ce qui fait la spécificité de l’homme cette partie qui lui est soumise, qu’il commande ! Là encore nous voyons l’usage de cette hiérarchisation entre les genres de choses : celles que l’on utilise et celles que l’on commande, sont inférieures à celles qui commandent. Or l’âme commande au corps, elle est donc ce « soi-même » que nous recherchions et dont il ne faut confier le soin à personne d’autre que soi-même !
Socrate fait à nouveau retour sur l’idée du dialogue comme communication entre les âmes [130e]. Il en revient à la situation de départ dans un ultime retournement du texte et confirme à Alcibiade qu’il est le seul qui s’intéresse vraiment à lui pour ce qu’il est, c’est-à-dire ni pour ses richesses, ni pour sa beauté, mais bien pour son âme, c’est-à-dire pour ce qu’est vraiment Alcibiade : une belle âme !
(p. 180) [132d] Moyens de connaître son âme
Nous l’avons vu à plusieurs reprises Socrate insiste sur le rôle du dialogue : le logos est en effet ce qui permet à l’homme de mieux se connaître. Le passage suivant, que nous avons étudié en détail, est celui où Socrate fait une analogie entre la vue et la connaissance : quel moyen l’œil a-t-il de se voir lui-même ? C’est-à-dire ici quel moyen l’âme, le soi, a-t-il de se connaître ? Comme l’œil se voit dans l’œil de l’autre [133a], l’âme se connaît dans celle d’autrui. De même que l’œil se reflète dans la pupille d’un autre homme, l’âme se connaît dans ce qui en constitue le divin ou l’excellence : la réflexion et la pensée. On peut ainsi lire ce passage comme une invitation à se connaître par la médiation d’autrui et à travers l’échange et le dialogue. Cette importance accordée à l’échange langagier, au logos qui est à la fois dialogue et raison, permet de faire le lien finalement entre la connaissance du sujet, celle de l’autre et celle de la Cité [133e].
Celui qui ignore ce qui lui est propre, ignore ce qui est propre aux autres et donc ce qui est propre à la cité : l’homme politique doit donc prendre soin de lui-même, de son âme, et ainsi connaître ce qui est bon et bien. La réflexion et la pensée sont la base de la construction éthique personnelle, fondement de la conduite éthique avec autrui, et donc de la science politique.
Socrate invite donc Alcibiade à se consacrer à l’étude de l’âme et à la réflexion, à l’étude du divin, avant de s’engager en politique. La connaissance de la justice et de la tempérance nécessaires à la politique (c’est-à-dire du comportement juste et convenable) ne peut s’acquérir que par l’amélioration de soi, le soin de soi.
(p. 189) [134e] Conclusion
La conclusion du dialogue rattache cette science et ce soin à la quête du bonheur : le bonheur n’est accessible que par un comportement convenable, respectant l’éthique et empruntant la voie de l’amélioration de soi. Cette amélioration conduit à la vraie liberté qui rompt avec l’esclavage, propre de celui qui n’est pas éclairé par la raison et la réflexion. Au passage, Socrate nous montre ici qu’être esclave c’est ici s’occuper de choses qui ne nous sont pas propres, se limiter à ces choses et aux techniques qui leur sont propres. Cela n’est pas sans rappeler l’allégorie bien connue de la Caverne qui, dans La République, compare les hommes à des êtes enchaînés qui ne contemplent que des apparences, des illusions ; et ne connaissent pas le vrai monde, le monde du Bien et des Idées, le monde de la raison accessible au philosophe. Ainsi, l’homme libre est un homme éthiquement éclairé, le citoyen est un homme libre qui laisse à d’autres le soin de ce qui ne lui appartient pas en propre et la cité libre est celle qui vise l’excellence morale et le divin.
Enfin, Socrate promet d’aider Alcibiade à s’améliorer (il ne se pose pas comme un maître savant comme les sophistes, mais bien comme un médiateur ou un conseiller qui peut aider Alcibiade à découvrir des vérités qu’il possède déjà sans en être conscient). Alcibiade promet quant à lui d’entreprendre cette réflexion, de se convertir à l’entreprise philosophique. Mais on peut remarquer à la toute fin du dialogue que Socrate doute néanmoins qu’il puisse résister aux flatteries et à la puissante séduction de la cité et de la démocratie, ce qui sera d’ailleurs le destin d’Alcibiade. Nous le retrouverons dans Le Banquet où il fera l’éloge de Socrate tout en regrettant sa propre nature qui l’empêche de suivre les conseils avisés qu’il lui offre. Mais Socrate souligne aussi sa propre fragilité face à la puissance d’Athènes et aux intrigues des démocrates.
En Conclusion
Le texte de l’Alcibiade comporte ainsi plusieurs dimensions complémentaires et rigoureusement liées entre elles.
S’il ne nous permet pas de répondre avec précision en ce qui concerne l’objet dont la cité doit s’occuper, ni de ce qu’est véritablement l’âme, il nous indique le chemin de la connaissance de soi par la réflexion et le soin apporté à celle-ci, mais aussi par le dialogue avec autrui qui est une mise en pratique de la réflexion et de la raison.
Il contient une théorie cohérente de la hiérarchie des priorités pour le sujet libre ; s’occuper de son âme, laisser le soin de son corps à d’autres et s’éloigner des travaux agricoles ou artisanaux, mais s’occuper uniquement de soi et du bien de la cité. C’est une théorie de la politique comme science réservée à une élite aristocratique capable de se consacrer à la réflexion (Platon proposera de confier le soin de la cité idéale aux philosophes eux-mêmes, seuls capables de distinguer la véritable justice) et d’être ainsi de « bon conseil ».
Ajouter un commentaire