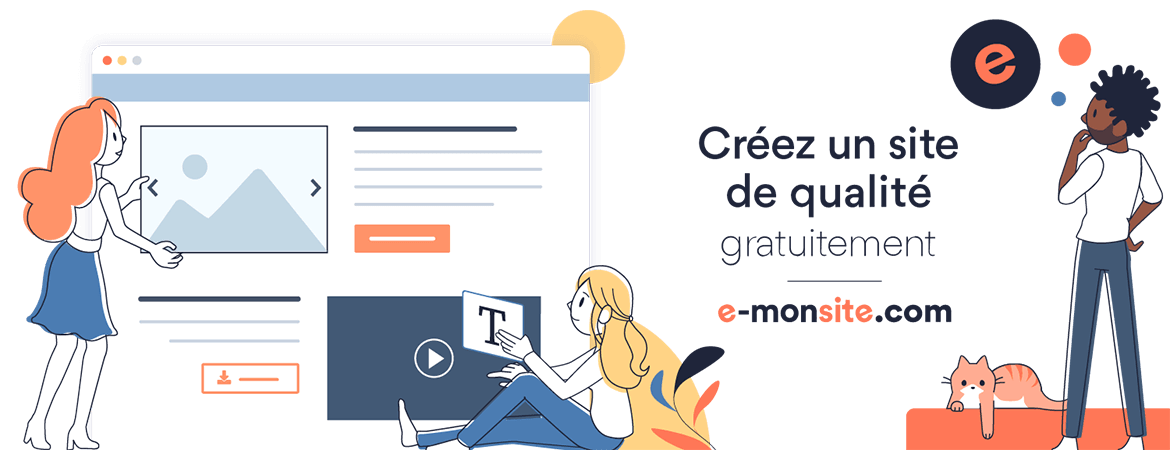- Accueil
- Humanités Littérature Philosophie
- HLP Term. L'Humanité en question
HLP Term. L'Humanité en question
2. Histoire et violence
Quelle est la place de la violence dans l'Histoire ? Peut-on se passer de violence ?
La violence est l'usage de la force brutale pour contraindre autrui. Il s'agit d'une notion qui semble bien désigner un comportement condamnable, un comportement qui nie la liberté et la dignité de l'autre. Selon Kant, un des commandements de la morale universelle est bien de ne jamais utiliser l'autre comme un moyen pour ses propres fins. Forcer l'autre à accomplir nos désirs ou nos volontés est un comportement immoral qui s'oppose en tout point à la civilisation des moeurs qui nous oblige à respecter autrui, à le considérer comme un alter ego. La violence apparaît comme un mode de relation et de gouvernement des autres à bannir absolument de nos sociétés.
Le paroxysme de la violence est atteint dans la guerre, elle correspond à une violence systématisée et concertée qui touche indifféremment les individus pris dans ses effets. La guerre correspond à un moment d'embrasement dans l'Histoire qui s'oppose à l'objectif recherché par toute société humaine : la tranquillité de la vie commune dans la paix. Cependant, la fréquence des guerres dans l'Histoire et l'importance qu'on leur accorde nous obligent à considérer ce moment de violence comme un moment sans doute nécessaire, peut-être comme un moyen de parvenir à la paix.
Dès l'origine, l'histoire comme discipline a partie liée avec la violence. Hérodote (Vème siècle av. JC), considéré comme le "père de l'histoire", narre dans son Enquête ("histoire" en grec veut dire "enquête", "recherche") les épisodes successifs des Guerres médiques qui ont opposé les Grecs à l'Empire Perse. La première Guerre médique se termine par la victoire célèbre des Grecs à Marathon, et la bataille de Salamine clôt la seconde Guerre médique. Bien que l'Enquête porte sur les relations entre les Grecs et les Perses au-delà des guerres, le propos de celle-ci est bien de raconter et d'expliquer la violence et la guerre. Le récit des batailles et des guerres constitue d'emblée le propos des récits historiques.
Il ne s'agit pas seulement sans doute de célébrer les vainqueurs dans de tels récits, mais aussi de comprendre la violence dans l'histoire et d'en cerner les causes. L'Histoire est racontée pour servir de leçon pour le présent : comment éviter les guerres ? Comment dépasser la violence ? Il s'agira donc pour nous d'interroger cette possibilité de se passer de la violence, dans l'Histoire et dans la société elle-même.
a. Modernité & progrès
Le lien essentiel entre Histoire et Violence correspond donc à une volonté de dépasser cette dernière, ou de l'inscrire dans un processus qui conduirait à la paix. La fin de l'Histoire et l'objectif de celui qui raconte celle-ci est bien d'affirmer la possibilité d'un progrès. Cette idée de progrès sera développée et assumée au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières comme une conception rationnelle l'Histoire. Les Lumières postulent que le développement de la raison par l'éducation, conjugué au développement des savoirs et des techniques va nous conduire à rejeter la violence et la guerre et à assurer la Paix perpétuelle et universelle. Il s'agit d'une vision escatologique de l'Histoire : la fin de l'Histoire consiste dans le règne de la Liberté et de la Justice. On retrouve cette croyance dans le progrès jusqu'aujourd'hui chez ceux qui annoncent que la mondialisation des démocraties libérales correspond à la Fin de l'Histoire et de la violence. Francis Fukuyama, philosophe américain suppose ainsi que l'Histoire est terminée et que la démocratie libérale clôt l'évolution politique et sociale. Il affirme la Fin de l'histoire dans la lignée de Hegel et de l'idéalisme allemand. On pourrait aussi évoquer l'ouvrage récent de Steve Pinker, rationaliste américain, qui prétend dans La part d'ange en nous, que nos sociétés sont de moins en moins violentes et meurtrières, réaffirmant la réalité du progrès à partir de chiffres et de statistiques fortement contestables.
Cette croyance dans le Progrès trouve sa source à la fois dans l'idée que l'Histoire peut nous enseigner à éviter les conflits et dans une vision rationnelle et idéaliste de celle-ci. Ainsi on trouve chez G. W. F. Hegel (1770-1831) l'affirmation la plus manifeste de cette philosophie du Progrès qui voit dans l'histoire une marche graduelle vers la réalisation de la Raison dans le Réel. Dans cette vision du monde, chaque peuple, chaque culture, chaque moment de l'histoire est une étape dans cette marche du Progrès et dans la réalisation de l'Esprit et de l'Idée. Ainsi, l'Histoire est-elle au sens strict un processus au cours duquel chaque stade est dépassé par le suivant et se rapproche de la concrétisation de la Raison, de la Liberté et de la Morale. L'ensemble de la culture obéit ainsi à une logique progressive. Si l'Histoire est en marche, elle avance cependant de manière dialectique, c'est-à-dire qu'elle traverse des crises, des oppositions et des conflits, qui sont dépassés et surmontés peu à peu. Cette représentation de l'Histoire caractéristique de l'Idéalisme allemand est aussi une des sources de la hiérarchisation des cultures et des peuples identifiant ceux-ci à des stades plus ou moins avancés dans la marche du Progrès. Centrée sur le modèle du progrès culturel et technique européen, Hegel voit dans la Prusse de son époque la "Fin de l'Histoire", la réalisation politique de la Raison et de la Liberté. Les autres civilisations sont rejetées dans l'arriération et exclues de l'Histoire ; ainsi le continent africain est-il pour Hegel hors de l'Histoire et rien ne peut s'y passer.
La dialectique permet d'intégrer au Progrès les crises et les conflits, cette violence que l'on est obligé de constater dans l'Histoire. Ainsi, nous dit Hegel, les guerres sont des moments nécessaires dans le cours de l'Histoire ; elles sont le signe d'une crise et de son dépassement. La violence des guerres napoléoniennes par exemple est vue comme un moyen par lequel l'idée de Liberté s'est répandue en Europe. Dans l'Histoire, nous dit Hegel, "rien de grand ne se fait sans passion" et sans violence, mais cette violence est en réalité une "ruse de la Raison" par laquelle s'accomplit la promesse du progrès. La Raison se réalise dans l'Histoire en transformant le monde par la violence et le conflit, mais dans le but de les dépasser. La violence est le moteur du progrès. Même Karl Marx, qui s'opposera à l'idéalisme de Hegel, reprendra à son compte une conception progressiste et dialectique de l'Histoire : celle-ci sera vue par lui comme conduisant à l'émancipation de l'homme à travers le processus dialectique de la lutte des classes. Bien qu'en rupture avec l'idéalisme, le matérialisme historique du marxisme adopte l'idée de Progrès et celle-ci s'affirme comme une conception commune. Cette vision caricaturale et eurocentriste n'est cependant pas encore aujourd'hui totalement discréditée puisque l'on a vu récemment un président français affirmer que "l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'Histoire" !
Peut-on adopter une telle représentation du Progrès qui hiérarchise ainsi les moments de l'Histoire et les Peuples ? Faut-il adopter cet "optimisme" historique qui promet une fin de l'HIstoire et une fin de la violence et du conflit ?
Il apparaît en effet rapidement que l'histoire récente, l'histoire du XXème siècle et les deux guerres mondiales, pourraient remettre en cause notre croyance dans le progrès. Les guerres et les génocides qui ont marqué ce siècle ne nous obligent-ils pas à renoncer à la philosophie du progrès ? Alors que Voltaire se moquait déjà dans son Candide d'une vision aussi naïve de l'Histoire (Voltaire s'oppose dans son texte à Leibniz pour lequel le monde réel est "le meilleur des mondes possibles"), elle semble désormais intenable. Il y a avec notre temps une rupture dans l'histoire : la violence génocidaire apparaît comme un "mal absolu" qui vient briser le cours du progrès. Elle nous oblige à jeter un éclairage rétrospectif sur l'ensemble de l'HIstoire, sur l'Histoire de la violence, qui nous renseigne sur l'existence des catastrophes qui auraient dû nous alerter quant au caractère illusoire de ce progrès. Qu'il s'agisse du génocide des Indiens d'Amérique ou du crime contre l'humanité qu'ont constitués plusieurs siècles d'esclavage et de Traite, ou encore des crimes de la colonisation, l'histoire peut en réalité apparaître comme "une suite de cartastrophes" davantage que comme une marche vers la Paix et la Justice. C'est le constat que fait notamment Walter Benjamin, dans son ouvrage Sur le concept d'Histoire publié en 1940, où il imagine un "Ange de l'Histoire" se retournant sur ce que nous nommons le Progrès et n'y voyant plus que l'amoncellement des massacres et des catastrophes.
Le doute qui porte sur cette idée du Progrès rejaillit finalement sur l'ensemble de l'Histoire de l'Humanité. D'un côté, nous sommes amenés à revoir le jugement qui a été porté sur les peuples et les cultures du passé, sur les peuples non-Occidentaux qui ont été exclus de l'Histoire pensée par l'Europe. De l'autre, nous sommes conduits à une relecture intégrale de l'Histoire de ce Progrès qui peut apparaître comme une suite de catastrophes, provoquées notamment par le développement de la technique et de l'industrie.
Ainsi l'ethnocentrisme qui consiste ici à donner la préférence à notre culture et à nos modes de civilisation, doit-il être rejeté en ce qu'il construit une histoire qui est d'abord celle des vainqueurs. La violence subie par les "vaincus" de l'histoire que sont les peuples asservis ou les catégories sociales et humaines minorées, est cachée par cette histoire du progrès. Il ne s'agit pas de déplorer simplement l'effacement des victimes de l'Histoire, mais aussi et surtout de révéler ce que ces oubliés portent comme possibilités de civilisation, de culture, comme possibilités humaines ignorées. La diversité des Humanités, révélée notamment par l'ethnologie (par exemple par Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques), fait la richesse de l'Histoire dès que l'on abandonne l'idéologie hiérarchisante du Progrès. Cependant, cet abandon ne va pas sans la reconnaissance d'une injustice et d'une violence au coeur de notre représentation du monde.
Par ailleurs, notre compréhension de l'histoire et de la part de violence qui l'anime est d'autant plus nécessaire à l'époque actuelle. En effet, notre moment historique est caractérisé par une extension sans précédent du pouvoir technique de l'Homme : nous sommes entrés dans ce que certains nomment l'Anthropocène, c'est-à-dire une ère au cours de laquelle l'Humanité étend son pouvoir et son action à l'ensemble de la Planète. Le danger que fait peser ce pouvoir sur l'environnement est aujourd'hui bien identifié : mise en péril des équilibres naturels et des milieux nécessaires à la biodiversité, pollution et surexploitation des ressources naturelles, réchauffement planétaire dû à l'émission de carbone. Cependant, il se double d'une mise en péril de l'Humanité elle-même, par l'industriatisation des techniques d'extermination et de déportation dont témoigne la logique des camps, mais aussi par la mise au point d'armes de destruction massive qui font peser sur l'Humanité le risque même de sa disparition. C'est de cette violence issue du Progrès technique dont nous parle Gunther Anders dans son ouvrage Le temps de la fin (1960). En effet, comme Rousseau l'avait déjà constaté, le progrès technique ne nous garantit en rien un progrès moral, au contraire, la technique semble imposer ses propres fins et l'Obsolescence de l'Homme. Ce que nous apprend le XXème siècle, c'est que non seulement nous sommes mortels, mais le genre humain lui-même est mortel. Auschwitz et Hiroshima nous apprennent l'évidence de cette éventualité : l'Humanité elle-même est mortelle, physiquement et moralement ! Ce changement de perspective ontologique (passer de "tout homme est mortel" à "l'Humanité est mortelle") nous ouvre les yeux sur une Histoire qui pourrait se faire sans l'Homme.
Faut-il cependant se résigner à ne voir dans le progrès que le progrès des machines de guerre et celui de la déshumanisation de l'Homme ? La guerre et la violence sont l'occasion d'une nécessaire interrogation de l'Humanité sur elle-même (l'Humanité en question) : l'Homme peut-il se passer de violence ? Peut-on se libérer d'une violence qui menace désormais l'Humanité de disparition ?
b. Histoire de la violence : peut-on se passer de la violence ?
Si l'on s'interroge sur la place de la violence dans la vie sociale et politique, il faut l'aborder selon les deux perspectives de la violence intime et personnelle et de la violence collective ou sociale. Il faudrait distinguer donc dans la violence, celle qui s'exerce au niveau des nations et des peuples, et celle qui s'exerce dans le domaine privé, dans la sphère de l'intimité et de la proximité des rapports sociaux. Nous reviendrons sur cette distinction, mais nous devons d'abord constater le caractère fondateur, fondamental d'une violence qui semble d'imposer dans tout rapport humain.
En effet, dans l'établissement des rapports entre les sujets, chacun semble être à la recherche de la reconnaissance de l'autre. Être reconnu par autrui comme un individu libre, obéissant à sa propre volonté, et non comme un objet parmi d'autres dont on pourrait se servir, est essentiel au sentiment de la dignité humaine. C'est sans doute l'objectif de chacun que d'affirmer ainsi sa liberté et son indépendance. Cependant, cette reconnaissance que nous recherchons n'est pas donnée d'emblée : elle s'obtient au cours d'une confrontation qui laisse une place à la violence physique ou symbolique. Tout se passe comme si dans les rapports interpersonnels, la violence était un moment de l'affirmation de soi face à autrui. C'est ce que constate Hegel dans la Phénoménologie de l'Esprit quand il détaille ce qu'il nomme la Dialectique du maître et du serviteur. Le maître est celui qui dans un rapport avec un autre individu va s'affirmer comme libre en affrontant le risque de la Mort, il s'agit à la fois d'un conflit physique et moral entre deux individualités. Mais en obligeant l'autre à la reconnaître, le maître n'obtient qu'une reconnaissance servile et contrainte. Il ne peut se définir encore comme libre en lui-même ; il faudrait pour cela qu'il soit reconnu par un sujet libre comme libre lui-aussi. De plus, en s'établissant comme maître, le sujet qui réduit l'autre à son service perd son indépendance et se met en réalité sous la dépendance de celui qui travaille pour lui, qui subvient à ses besoins. La dialectique est ainsi une suite de moments où les rapports s'inversent, se retournent, où l'esclave se révèle nécessaire au maître et s'affirme donc à son tour comme un individu libre. L'affrontement des consciences passe par des moments de violence nécessaires qui ne seront surmontés que lorsque s'ouvrira la possibilité d'une reconnaissance mutuelle. Cette analyse du processus d'affirmation et de reconnaissance des sujets dans leur confrontation montre bien l'importance de la violence dans les rapports entre les individus et dans la lutte pour le reconnaissance de leur droit et de leur liberté.
Dans les rapports entre les individus, on ne semble pas pouvoir se passer de violence (une violence qui peut être physique, mais aussi symbolique) et celle-ci fonde le droit. Cependant, elle est comprise comme un moment dans l'affirmation de sa liberté et se résout finalement dans la reconnaissance mutuelle. La violence semble vouée à être surmontée et dépassée. Il semble en aller de même dans les rapports entre les Nations et les peuples qui s'affrontent au cours de l'Histoire, mais qui au terme du processus, assureront leur coexistence et leur indépendance. Nous retrouvons ici la perspective du progrès telle que nous l'avions envisagée déjà avec Hegel. Tant que nous en sommes à l'établissement des relations entre les hommes et entre les nations, la violence est inévitable. Cependant, elle permet que s'établisse le règne de la Paix et de la Concorde au terme d'un processus dialectique qui aboutissent à sa disparition. Le règne de la violence est voué à établir et céder la place au règne du Droit. Le caractère fondateur de la violence est ainsi souligné : la violence fonde le droit. Il ne s'agit pas simplement de fonder le Droit sur le "droit du plus fort" dont Rousseau nous avertit déjà de la fragilité (dès que le plus fort tourne le dos, rien n'empêche l'autre de s'enfuir), mais bien de saisir que la confrontation est le moyen historique d'établir peu à peu des règles de coexistence qui seront la garantie d'une paix assurée.
Alors que l'analyse des rapports sociaux et internationaux à partir de la violence pouvait paraître une vision pessimiste des relations humaines, l'orientation de cette reconnaissance dialectique est bien "optimiste" dans le sens où elle promet le dépassement de la violence au bout du chemin. La violence y est vue comme un moyen au service d'une finalité juste : l'établissement du Droit et de la Justice dans le dépassement du conflit. Cette compréhension de la violence comme moyen est partagée par de nombreuses approches, pourtant elle semble à nos yeux manquer l'essentiel de ce phénomène. Au lieu de s'interroger sur la place de la violence dans un processus qui est d'emblée orienté vers son dépassement, ne faut-il pas s'interroger sur ce qu'elle est en elle-même ?
Nous avons établi l'importance de la violence dans l'établissement du Droit, ainsi celle-ci apparaît comme fondatrice. La violence fondatrice impose un droit qui n'est pas seulement celui du plus fort, mais qui peut être celui qui protège la société et les populations des abus de pouvoir. En effet, le lien social et la constitution des groupes sociaux et politiques permet d'asseoir le droit sur une force et une violence qui apparaissent comme légitimes car résultant d'une union et d'une association des citoyens. Si la force est le moyen d'établir la volonté générale et de fonder sur elle le Droit, elle apparaît comme un élément de ce "Contrat social" que Hobbes comme Rousseau placent à la base de la vie en société. En ce sens, la violence n'est pas seulement "fondatrice", elle est aussi "conservatrice" puisqu'elle permet de défendre le droit civil établi en commun et légitimé par la vie en société. La force du droit devient ainsi la seule force légale et légitime : "l'Etat a le monopole de la violence légitime", affirme en ce sens le sociologue Max Weber (1864-1920). On ne peut ainsi se passer de la violence dans la vie en société car c'est elle qui établit et protège le droit légitime des peuples à se gouverner eux-mêmes.
Nous devons alors reconnaître que la violence est partie prenante de l'ensemble des phénomènes humains, qu'il s'agisse des phénomènes personnels ou collectifs. Il ne s'agit plus alors d'envisager la violence comme "un moyen au service d'une fin", mais bien comme le ressort des relations humaines. La violence ne disparaît pas avec l'avènement de la société, elle demeure cachée en son sein et en constitue la secrète condition. Alors que le stratège prussien, Carl von Clausewitz (1780-1831), voyait dans la guerre la continuation de la politique par d'autres moyens ; il faudrait dire avec le philosophe Michel Foucault que c'est plutôt la politique qui est la continuation de la guerre et de la violence. Ce dernier affirme en effet dans ses cours au Collège de France de 1976, intitulés "Il faut défendre la société", que la guerre est "le chiffre de la paix", qu'elle est le secret moteur de nos rapports sociaux et politiques. Ceux-ci consistent dans l'établissement de rapports de force dont la violence est plus ou moins apparente, mais qui montrent le conflit au coeur de la société et de la politique. Le Droit et les Lois sont établis dans la guerre, les Nations tracent leurs frontières dans les Traités et suite aux conflits, l'ensemble de nos droits sont les fruits d'une violence diffuse entre les classes sociales, un affrontement entre différentes pouvoirs traverse notre société. Mais cette violence, et c'est cela qui fait l'originalité de la thèse de Foucault, n'est pas abolie par le Contrat social, celui-ci n'est au contraire qu'une "fiction" qui ne fait que consigner un rapport de force et des luttes toujours vives. Le moteur de la politique sont ces affrontements et cette violence. On peut ainsi dire que la violence ne s'absente jamais de la vie en société, même si elle est cachée ou se fait à bruits étouffés.
Nous sommes ici loin d'une vision telle que celle de Norbert Elias qui voyait le processus de civilisation des moeurs comme l'organisation d'un recul de la violence dans les rapports sociaux, comme une euphémisation de la violence du pouvoir. L'effort fourni par la culture et la société vise à inventer selon lui des rituels, des règles, à normaliser des conduites qui évitent la violence. Pourtant, celle-ci demeure, nous l'avons vu, ce qui sous-tend les rapports entre les individus et les relations de pouvoir. C'est qu'elle constitue une part inavouable et irréductible de la nature humaine, aussi bien collectivement qu'individuellement. Ainsi, il faut sans doute admettre que les pulsions inconscientes qui nous animent nous portent aussi à la violence. Sigmund Freud dans son analyse révèle que ces pulsions constituent une part inconsciente mais essentielle du psychisme humain. Il identifie trois instances présentes chez tout sujet. Le ça peut être vu selon lui comme le réservoir de ces pulsions inconscientes qui nous poussent à assouvir des désirs inavouables : pulsions sexuelles et pulsions de violence. Cette instance qui n'obéit qu'au principe de plaisir est modérée par le Surmoi, instance correspondant aux interdits parentaux et socio-culturels en grande partie inconscients. Enfin, le Moi qui correspond au sujet conscient, tente de maintenir un équilibre difficile entre ces deux instances et de les concilier avec le principe de réalité qui comprend aussi les exigences sociales et nos rapports avec les autres.
Droit collectif résister à la violence, etc.
Distinctions importantes
Droit positif / Droit naturel
Fin / Moyens
Violence légitime / Violence illégitime
On arrive ici au plus proche de l’idée d’un contrat social qui reposerait sur l’union des citoyens entre eux afin de garantir une certaine égalité, équité et échapper au simple fait de la violence et du rapport de force.
L’effort social est un effort pour se dégager de la violence – inventer des rituels, des politesses, des lois et des règles
Vision progressiste de Norbert Elias – sociologie /politique de limitation de la violence / intégration du contrôle de la violence
Processus de civilisation qui nous éloigne de la violence, qui la discipline
Freud, Malaise dans la civilisation (1929)
Pourtant comme le soulignait Freud, ce contrôle peut conduire à un Malaise dans la civilisation – la violence refoulée peut s’extériorisée de manière brutale, contre les minorités, contre une cible qui devient un bouc émissaire (théorie du bouc émissaire de Girard – toute société est fondée sur la violence à l’égard d’un tiers qui est par là désigné comme sacré).
Qu’en serait-il d’une Histoire vue par ces minorités boucs émissaires ?
Ajouter un commentaire