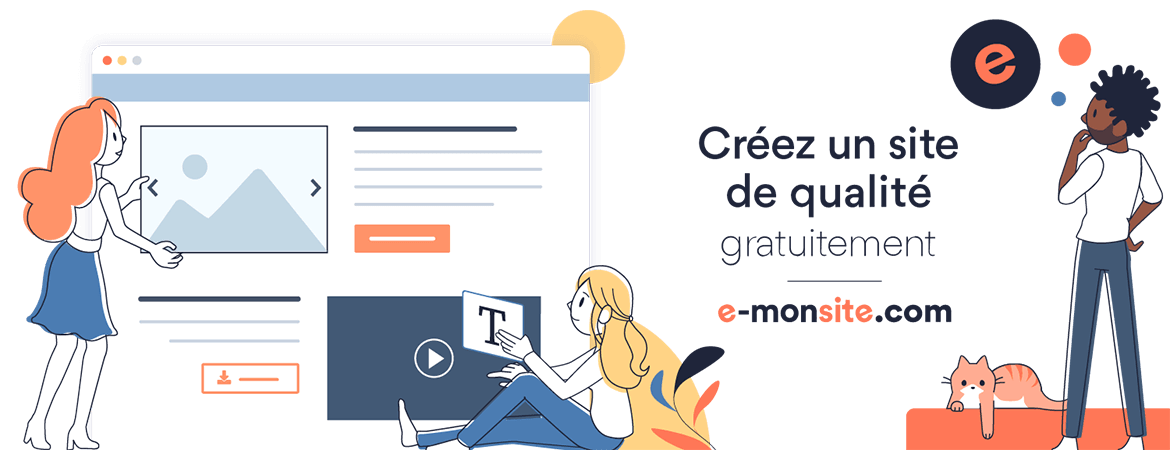- Accueil
- Cours Terminale Générale
- La morale et la politique
- Politique Morale 1 : L'Etat
Politique Morale 1 : L'Etat
-
L’Etat doit-il viser le bonheur des individus ? Pourquoi l’Etat devrait-il limiter son pouvoir ?
-
Une société sans Etat est-elle possible ? Le but de l’Etat est-il la paix ? L’Etat doit-il garantir le bonheur des citoyens ?
-
Peut-on concevoir une société sans Etat ? L’Etat peut-il être impartial ? L’Etat a-t-il tous les droits ?
-
La liberté individuelle est-elle un danger pour l’Etat ? L’intervention de l’Etat est-elle nécessaire pour réduire les injustices ?
Problématique générale
L’Etat est-il le garant de la justice et de la liberté ?
L’Etat est une notion moderne, puisque le terme apparaît pour désigner une communauté politique qu’à partir du XVème siècle. L’Etat succède à la Cité, comprise comme lieu de vie commun où chacun exerce sa responsabilité de citoyen (cite : polis, politique). Nous verrons que le passage à l’Etat recouvre une modification du sens donné à cette communauté de vie.
En effet, l’Etat est une construction artificielle qui succède à la conception naturelle de la Cité comme rassemblement de familles, de clans. Un degré dans l’artificialité et dans le détachement de l’état naturel est franchi avec l’Etat. Il s’agit d’une institution qui prétend transcender les hommes.
Qu’il soit issu d’un Contrat ou de la formation d’une communauté d’intérêts, l’Etat soumet à son autorité les individus qui le composent. Instance dialectique, l’Etat permet la liberté et la sécurité de chacun. Ainsi, il arbitre les conflits entre les intérêts particuliers et prétend à constituer l’intérêt général (et à le favoriser au profit de l’ensemble de la société). Il organiserait donc les équilibres de la société civile, mais au prix tout de même d’une soumission à son autorité. Une première opposition pourrait ainsi être trouvée entre l’Etat et la Société civile, entre la finalité libératrice de l’Etat et les nécessités de domination et de pouvoir qui en constituent le quotidien.
L’Etat se présente-t-il alors comme un « mal nécessaire » qui permettrait la vie en commun au prix d’une part de liberté. Mais peut-on ainsi négocier sa liberté ?
Par ailleurs, l’Etat est bien ce qui étend son pouvoir sur, d’une part, une population, les individus qui la compose, et d’autre part, un territoire ou une nation. Il a été défini comme l’instance la plus haute de la société qui détiendrait « le monopole de la violence légitime ». On comprend néanmoins que cette violence pose la question de sa limitation, la question des « abus de pouvoir ».
L’Etat s’expose ainsi selon plusieurs angles à la critique : à la fois critique de ses excès, mais aussi critique de sa légitimité.
Le rôle de l’’Etat est-il d’arbitrer les conflits entre les libertés individuelles ?
INTRODUCTION
L’Etat est souvent compris comme une institution créée afin de réguler les conflits entre les intérêts particuliers, afin de faire émerger l’intérêt général et de le favoriser. L’Etat serait alors la condition nécessaire à la vie en commun, au respect de chacun, de ses droits et de ses libertés. C’est notamment la conception qui anime les démocraties en ce qu’elles se fondent sur le transfert de souveraineté du peuple sur l’Etat, selon diverses modalités et selon divers contrats de société.
Pourtant, afin de réguler les conflits et de gérer les populations, l’Etat n’est-il pas obligé de contraindre les libertés des individus, de les limiter ? En ce sens, l’Etat et ses lois apparaissent bien comme des contraintes qui s’opposent à l’individu et ses aspirations. Comment concilier le respect des libertés et l’obligation de limiter ces mêmes libertés afin d’éviter qu’elles n’empiètent les unes sur les autres ?
Nous verrons dans un premier temps, comment s’instaure la légitimité de l’Etat face aux libertés individuelles. D’où lui vient ce pouvoir de contrainte et de régulation des libertés ? Ainsi, nous remarquerons que l’Etat n’apparaît légitime que lorsqu’il protège les libertés des citoyens. Mais, s’il ne s’oppose pas aux libertés du citoyen, l’Etat en revanche les limite ou les régule. L’exercice de la limitation des libertés individuelles n’est pas sans risque, puisqu’elle peut être l’expression d’une domination économique et politique. Comment alors pouvons-nous nous en prémunir et permettre à l’Etat d’être réellement le lieu où s’expérimente la liberté des citoyens et son gouvernement ?
1. Quelle est la source de la légitimité de l’Etat qui lui permet de contraindre les individus ?
-
De quel droit l’Etat exerce-t-il un pouvoir ? L’Etat favorise-t-il la liberté ? L’Etat peut-il assurer à la fois la liberté et la sécurité des individus ?
En effet, une des fonctions de l’Etat tel que l’a défini la pensée politique moderne est bien de contraindre les libertés. Il s’agit d’instaurer un Bien commun et d’orienter les comportements des individus afin qu’ils participent à son élaboration. Pour ce faire, il est nécessaire de faire taire les conflits entre les libertés des individus.
a) Le contrat social à la source de l’Etat ?
Thomas Hobbes, Léviathan (1651)
C’est ainsi que Hobbes comprend le Contrat social : il s’agit de transférer la Souveraineté à un « être artificiel », à une instance politique, qui devient alors la seule détentrice du pouvoir de contraindre. Ainsi, elle assure la sécurité de chacun en empêchant l’affrontement des volontés. Hobbes part du constat de l’impossibilité d’une liberté naturelle : en effet, celle-ci est toujours mise à mal par les velléités de domination des uns et des autres. « L’homme est un loup pour l’homme », nous dit Hobbes, c’est-à-dire que l’état de nature est un état de « guerre de tous contre tous » dans lequel personne n’est en sécurité. La liberté naturelle est toujours menacée et soumise. Elle ne s’affirme que dans l’affrontement infini. Pour éviter cet affrontement, le Contrat social consiste alors à abandonner la souveraineté à un despote qui détient les pleins pouvoirs pour régler les relations des citoyens.
Il y a donc bien selon cette approche une opposition entre les libertés individuelles et l’Etat, mais l’Etat est ici le terme de cette opposition. Il résout l’opposition en restreignant la liberté sauvage, la liberté d’affronter l’autre. L’Etat empêche la Guerre civile ! Mais, comme la liberté à l’état naturel est intenable, cet Etat coercitif va néanmoins améliorer le sort des individus. En effet, il permettra l’expression de libertés limitées à l’espace privé et au commerce, les libertés civiles ou libérales qui se nichent dans les interstices des lois édictées par le Léviathan. Si l’on y gagne selon Hobbes, c’est que la situation de départ est intenable. On y gagne une liberté limitée, mais garantie.
La légitimité de l’Etat tient donc à ceci qu’il permet de concilier la sécurité et la liberté au sein de la société. Il empêche ainsi l’opposition des libertés en les restreignant à la sphère privée et à la liberté de commerce et d’enrichissement. On peut ainsi dire qu’il s’oppose à la liberté individuelle dans sa pleine acception, mais pour assurer d’autant mieux l’exercice des libertés civiles. Sa légitimité vient donc du Contrat social que passent les hommes et qui les amène à aliéner une part de leur liberté et de leur souveraineté au profit de l’Etat, seule instance capable d’assurer la Concorde nécessaire à la poursuite du Bien commun. La contrepartie de cet abandon de souveraineté est une liberté amoindrie mais assurée.
Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social (1762)
Pourtant, ne peut-on comprendre ce Contrat social comme compatible avec la liberté ? En effet, s’il s’agit d’un Contrat (un pacte, une convention) qui est consenti par les membres de la communauté, par les citoyens, ne peut-on affirmer qu’ils l’ont passé en toute liberté. C’est le sens de l’approche de Rousseau qui comprend le Contrat Social comme l’expression d’une liberté de seconde nature, une liberté socialisée (qui ne ruine pas la liberté naturelle) qui consiste dans le fait de se donner à soi-même sa propre loi : l’autonomie est ainsi liberté ! Selon Rousseau, le Contrat social crée l’égalité entre les hommes et permet de surmonter la limitation de la liberté individuelle par la vie en société en inventant une liberté « au second degré », une liberté de l’homme socialisé, une liberté morale, qui consiste à se donner sa propre loi.
Rousseau, Du Contrat social : « Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. »
L’Etat substitue à une liberté naturelle, une liberté éduquée, de droit et de devoir qui fait entrer de plein pied l’homme dans la sphère de la moralité. De même, à l’égalité naturelle (qui comprend aussi les inégalités physiques), le Contrat social substitue une liberté de droit, une égalité morale et légitime.
L’Etat assurerait alors les libertés individuelles dans les limites qu’elles se sont elles-mêmes imposées. L’opposition entre les libertés individuelles et l’Etat aurait alors peu de sens, puisque l’Etat émanerait des libertés contractuelles, et les libertés civiles seraient garanties par l’Etat !
b) La loi et la justice
L’Etat apparaît comme issu du Contrat social, un contrat implicite passé entre les citoyens pour mettre leur liberté sous la protection des institutions collectives. Mais qu’est-ce qui peut nous garantir que les lois qui sont appliquées en commun correspondent à nos intérêts, nos désirs, notre volonté ?
En réalité, la question ne se pose pas de cette manière selon Rousseau
Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762)
La légitimité de la loi et de l’Etat ne vient pas d’une volonté particulière ou des intérêts particuliers, mais bien de ce qu’il nomme l’intérêt général, la volonté générale.
Se pose en réalité la question de la légitimité de la loi, les lois imposées par l’Etat sont-elles jutes ? Correspondent-elles à mon sentiment de justice et de vérité ?
La loi est juste si et seulement si elle correspond à la volonté générale selon Rousseau.
Pourtant, cela ne pose-t-il pas la question de la justice et de la majorité ? La loi de la majorité est-elle toujours juste ? Comment faire respecter les droits des minorités, des marginaux, du petit nombre ?
Deuxième question : la loi commune s’impose-t-elle toujours à moi, même lorsque je m’en réfère à une loi supérieure, à une loi naturelle ou divine ?
Exemple d’Antigone : la loi de la Cité peut s’opposer à d’autres lois ou à des lois considérées comme plus élevées.
La légitimité de l’Etat consiste à garantir les libertés et à assurer le bien commun, en faisant respecter (par des lois, par l’exercice de la justice, mais aussi par celui de la punition et de la violence légitime) des règles d’exercice de ces libertés. Il endosse donc le rôle de l’arbitre impartial qui équilibre les échanges entre les hommes.
Spinoza, Traité Théologico-politique (1670)
Comme le souligne Spinoza dans son Traité Théologico-politique, l’Etat n’est pas une institution crée pour soumettre et dominer, mais au contraire pour libérer les individus.
Mais cet état garant des libertés et des droits de chacun ne peut être tel que s’il s’organise selon un certain nombre de principes libéraux, de principes qui respectent la liberté individuelle pour autant qu’elle ne s’oppose pas au pouvoir et qu’elle n’entend rien régenter par elle-même.
Il y a donc aussi dans cette position de Spinoza une critique de tout pouvoir qui entendrait limiter la liberté de réflexion et d’expression. Il est cependant manifeste que dans le cas d’un pouvoir exercé par un seul, il apparaît difficile de prétendre que celui-ci autorisera sans réponse et sans répression, l’expression d’une opposition aussi bien intentionnée soit-elle !
C’est son arbitrage et les limites qu’il pose par la loi qui permet à l’Etat d’assurer la réalité de la liberté humaine et de faire rentrer l’homme dans ses droits. Ainsi, pour Hegel, n’y-a-t-il qu’une opposition dialectique entre l’Etat et les libertés individuelles. Elle se résout et se surmonte dans l’exercice de la liberté
Friedrich Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire (1837)
Selon Hegel, ce n’est que par l’Etat que la liberté humaine peut devenir réelle. L’homme n’est pas libre à l’état naturel, il est sans doute libre en lui-même, mais cette liberté n’est pas alors concrète, effective. L’Etat permet à la liberté humaine de se réaliser. Pour Hegel, l’Etat moderne, celui qui s’est affirmé depuis la Révolution française, est la forme aboutie de l’organisation des sociétés humaines. Il ne peut être dépassé puisqu’il représente la volonté de liberté de l’homme de façon consciente : par exemple avec les Droits de l’homme et du citoyen. L’Etat se pose comme arbitre entre les différentes composantes de la société civile, de la société du travail. L’arbitrage de l’Etat est pensé comme ce qui rend possible une liberté éclairée dans une société apaisée. Pourtant, on ne peut être sûr que l’Etat parvienne à harmoniser ces inégalités de condition et d’intérêt, ces différentiels de liberté qui caractérisent la société humaine, et notamment nous l’avons vu la société marchande. En ce sens, on ne peut affirmer que l’Histoire est finie avec l’avènement de l’Etat...
Pourtant, n’est-ce pas une illusion que de penser que l’aliénation de ma liberté dans l’Etat permet de la garantir ? Ce serait alors une remise en cause de son rôle et non seulement de son efficacité. Ne peut-on imaginer un Etat qui confisquerait ce pouvoir au profit d’une caste, d’une classe sociale ou d’un parti ? Mais surtout, est-il réellement possible d’accepter une liberté « à la découpe », qui pourrait se penser comme limitée ? N’est-il pas antinomique de parler de limitation de la liberté ? Peut-on être un peu libre ou pratiquement libre ? Dans ce marchandage entre les libertés et la sécurité, l’individu ne vend-il pas son âme à l’Etat ?*
2. Faut-il limiter le pouvoir de l’Etat ?
On peut penser que l’Etat n’est pas cet arbitre impartial qui assure l’équilibre et la justice dans le règlement des conflits entre les individus. Au contraire, il est possible d’envisager le pouvoir qu’exerce l’Etat sur les libertés comme une expression de la domination politique d’une classe. L’Etat peut en effet être détourné de ses buts avoués, il peut devenir un Etat totalitaire qui brime les individus et les empêche d’exercer leurs droits et leurs libertés. Il échapperait ainsi au Contrat originel pour servir finalement les intérêts de quelques-uns. C’est la problématique de l’excès du pouvoir de l’Etat. L’Etat a le monopole de la violence légitime selon Max Weber, mais ne risque-t-il pas d’abuser de son pouvoir ? Ne peut-il retourner sa puissance contre les individus ou la société ?
a) L’impartialité de l’Etat est-elle une illusion ?
Seulement, cette puissance aliénée de l’Etat n’est-elle pas d’abord une création de l’homme qui devient une réalité politique qui le contraint ? C’est l’idée d’un penseur anarchiste comme Max Stirner : l’Etat n’est qu’un fantôme, une idée fixe qui limite l’expression de mes capacités, de ma liberté. Il détourne les forces de l’individu pour le faire adhérer à un projet commun qui est lui-même ! Il s’oppose donc par essence à la liberté individuelle, à l’égoïsme que Stirner veut remettre au goût du jour. Il n’est pas impartial en ce qu’il défend son propre intérêt, sa conservation en tant qu’instance politique. C’est la position de l’individu qu’il met en cause, mais c’est aussi celle des différentes composantes de la société.
Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884)
L’Etat sous le regard d’Engels apparaît comme une tentative pour recouvrir et cacher les divisions qui parcourent la société. Il est même l’agent qui permet que la société « tienne », malgré les tensions et la révolte légitime des plus démunis. Le pouvoir de coercition n’est pas un accident, une nécessité malheureuse de l’exercice du pouvoir de l’Etat pour poursuivre le Bien commun. Au contraire, l’essence de l’Etat est la protection des dominants par tous les moyens de la police et de la justice. S’il est le possesseur de la « violence légitime », c’est dans le sens où il peut exercer une violence qui sera légitimé par la tenue de l’ordre social. C’est donc une instance de répression.
Protection de la propriété privée et des échanges commerciaux par exemple, l’Etat prétend assurer la sécurité et la liberté alors qu’il protège les possédants et assure leur liberté de dominer. L’Etat est donc le résultat d’une lutte des classes et d’un rapport de force dont il ne fait que valider l’inégalité. Sa légitimité est imaginaire et se construit dans l’usurpation. Il ne s’agit pas de protéger les libertés individuelles, mais de protéger les puissants. L’Etat, par l’appareil idéologique, par l’éducation, par sa police et sa justice, quadrille la société et fait accepter un état de fait dont il cache la véritable nature. Il s’oppose donc aux libertés individuelles lorsqu’elles s’attaquent à la position des possédants.
L’Etat n’est peut-être pas un arbitre entre les libertés, mais bien un parti : il ne cherche, d’après Engels ou Marx, pas à concilier les libertés mais à assurer la domination de certaines libertés sur d’autres. De la même façon que dans l’œuvre de George Orwell, La Ferme des animaux, les cochons qui ont pris le pouvoir à la faveur d’une révolution « socialisante » de tous les animaux déclarent que finalement « Tous les animaux sont égaux, mais que les cochons sont plus égaux que les autres », l’Etat déclare que tous les citoyens sont libres et égaux mais que certains sont libres d’être favorisés, de dominer et d’exploiter les autres... C’est une nouvelle conception du pouvoir qui se fait jour et qui envisage non plus l’Etat comme l’instrument de la pacification des sociétés, mais au contraire l’Etat comme un lieu de guerre. C’est la guerre des classes entre elles, l’opposition dans l’Histoire des riches et de pauvres, des dominants et des dominés, des propriétaires et des travailleurs… Cette vision critique, même si elle peut être contestée, a le mérite d’attirer l’attention sur la persistance des inégalités et des dissensions au sein de nos sociétés policées et de remettre en cause le mythe d’une fin de l’histoire atteinte grâce au développement de l’Etat libéral et démocratique...
Max Stirner, L’Unique et sa Propriété (1845)
Selon le philosophie anarchiste Max Stirner, on ne peut faire confiance à l’Etat qui en réalité est une création monstrueuse des hommes pour se domestiquer eux-mêmes. En effet, selon ce penseur allemand qui fréquentait les mêmes cercles socialistes que Marx, la création de l’Etat est celle d’une institution de surveillance, de police, dont le seul but est de détourner l’individu de son seul intérêt, de sa véritable liberté. L’Etat bride la liberté et la volonté de l’individu au profit de processus d’asservissements qu’il ne sert qu’à justifier. Il est finalement un « grand mot », ce qu’il appelle un « fantôme » qui doit sa puissance à la foule de ceux qui croient en lui. L’Etat égalise, rabote et finalement rend le Moi impuissant à se réaliser. Il détourne à son profit l’énergie et la créativité des individus, au profit d’une collectivité qui est en grande partie fictive et qui défend en réalité les intérêts d’une classe.
Ainsi peut-on penser à cette sentence de Nietzsche : « L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : "Moi, l'État, je suis le Peuple“. »
Loin de représenter le peuple, l’Etat historique n’est-il pas plutôt l’expression du pouvoir d’une classe, de la classe dominante de chaque époque ? Même en démocratie, les valeurs qu’il défend ne sont-elles pas celles qui protègent les dominants, ceux qui possèdent ? On peut en effet comprendre, avec Marx et Engels, l’Etat comme un moyen d’oppression au service de la classe dominante.
b) L’union des citoyens par l’Etat est-elle une illusion ?
Non seulement, les inégalités perdurent au sein de la société organisée par l’Etat, mais l’on peut voir que les dissensions sont sans doute à l’origine même de cet Etat.
Michel Foucault, Dits et Ecrits II (1976)
Ainsi Michel Foucault dans ses cours au Collège de France établit-il l’origine guerrière de l’Etat et, bien plus encore, la continuation de la guerre à l’intérieur des rapports sociaux organisés par l’Etat. L’Etat ne permet pas alors l’harmonisation des libertés, mais il recouvre en réalité la guerre et l’affrontement de ces libertés d’une idéologie de l’ordre.
De la même façon que selon Carl von Clausewitz (1780-1831), militaire autrichien, comprend dans son ouvrage stratégique intitulé De la Guerre, que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, on peut dire avec Foucault que l’Etat et la politique sont la continuation de la guerre dans la société.
Le danger qui pèse sur l’Etat est celui des inégalités et des rivalités de condition. Comment dès lors assurer une juste organisation des libertés ? C’est l’articulation entre la société civile et l’Etat qui est au cœur de cette problématique. En effet, la société civile est le lieu de l’affirmation des libertés individuelles, mais aussi de libertés particulières qui veulent s’affirmer dans l’espace public. Lieu de l’affirmation des libertés, la société civile est l’objet de l’action de l’Etat. Il met en ordre cette société civile et exerce sur elle son pouvoir. Mais peut-on penser ce pouvoir autrement que comme une domination, une contrainte qui viendrait de l’extérieur ? Ne faut-il pas revoir notre conception du pouvoir de l’Etat et de la liberté si l’on veut comprendre les effets d’obéissance et de gouvernement ?
3. L’Etat ou le gouvernement des libertés ?
-
La liberté individuelle est-elle un danger pour l’Etat ? L’Etat favorise-t-il la liberté ?
L’Etat n’est pas seulement un facteur d’oppression et une contrainte sur les libertés. Il est le lieu de l’exercice du pouvoir, il est peut-être le nom que l’on donne au pouvoir politique tel qu’il s’est affirmé : sur un territoire, sur une population et en vue de la sécurité…
On le conçoit facilement, l’Etat moderne se développe en même temps que s’organise la société civile. Il y a deux dimensions : l’espace privé et l’espace public. Les lois et les contraintes s’adressent de l’un vers l’autre. Pour que s’organise un Etat, il faut qu’il y ait une forme d’adhésion à la forme politique choisie, il faut que les libertés trouvent à s’inscrire dans les espaces publics ou privés, à se distribuer entre public et privé. Tout l’enjeu de l’organisation de l’Etat démocratique consistera à articuler ces domaines et à y faire jouer les libertés. Nous rejoignons encore une fois la question de l’espace public comme lieu d’une expérimentation, expérimentation au cours de laquelle les individus se constituent en public..
a) La société civile et l’Etat : opposition ou participation ?
Emile Durkheim, L'Etat et la société civile (1916)
L’organisation des libertés est aussi liée à ce que Durkheim nomme des « groupes restreints », c’est-à-dire des partenaires tels les syndicats, les partis ou les associations qui organisent et regroupent les intérêts divergents et les revendications de libertés particulières. Emile Durkheim (1858-1917) est le fondateur de la sociologie comme discipline scientifique, avec Les règles de la méthode sociologique qui consistait à « traiter des faits sociologiques comme des choses ». Selon lui, le pouvoir de l’Etat est limité et circonscrit par l'existence de contre-pouvoirs, de corps intermédiaires. C’est le propos de la sociologie que d’explorer les manières dont le gouvernement de l’Etat s’établit et s’affirme sur les individus qui composent la société civile. Mais nous voyons par-là même que l’Etat est un concept qui a partie liée avec l’idée d’un pouvoir diffus dans la société et dans les individus. Il ne s’agit pas seulement d’un pourvoir central qui agit extérieurement sur l’ensemble de la société, mais d’un pouvoir diffus dont les relais sont multiples. Le pouvoir est ainsi un rapport entre cette organisation de la société et les individus, rapport qui passe par une hiérarchisation et une multiplication des relais du pouvoir politique. On pourrait ainsi aborder l’Etat non plus comme une instance externe qui agirait sur la société et les individus, qui contraindrait les libertés, mais comme une puissance immanente, un gouvernement interne à la société et sans doute aux individus…
Au-delà des nécessités de l’organisation des libertés, il est possible en effet d’interroger le rôle du gouvernement et de l’Etat dans la formation même des libertés !
Le gouvernement qu’exerce l’Etat est d’abord un gouvernement qui porte sur les individus et qui agit sur les libertés. L’Etat, comme mode de gouvernement, produit des libertés. Il joue des aspirations des individus, il embarque les libertés individuelles dans la production d’une vie sociale.
b) Peut-on gouverner en encourageant les libertés ?
La liberté est partie prenante de l’acte de gouverner. Elle est une condition de possibilité du gouvernement. Ainsi Michel Foucault souligne-t-il dans ses cours (Sécurité, Territoire, Population – « Cours au collège de France. 1977-1978 ») que la liberté est une composante de l’art de gouverner, notamment de l’art libéral tel que nous l’avons aperçu lors du cours sur « Les échanges ». On pourrait même aller jusqu’à la concevoir comme une production de l’acte de gouverner : la liberté (et notamment la liberté de commerce, celle du marché, de l’’exercice du droit de propriété, mais aussi la liberté de discussion, éventuellement liberté d’expression, etc) est nécessaire à l’exercice du gouvernement libéral. Il fonctionne à la liberté, Foucault nous dit qu’il « consomme » de la liberté.
Dans Naissance de la Biopolitique, « Cours au collège de France. 1978-1979 », il insiste sur cette implication d’une production stratégique de la liberté par le pouvoir : « la nouvelle raison gouvernementale a donc besoin de liberté, le nouvel art gouvernemental consomme de la liberté. Consomme de la liberté, c’est-à-dire qu’il est bien obligé d’en produire. [...] Le libéralisme formule ceci, simplement: je vais te produire de quoi être libre. Je vais faire en sorte que tu sois libre d’être libre». Il relève ce faisant au cœur de la pratique libérale du gouvernement, un « rapport problématique » entre la production de la liberté dont a besoin le gouvernement et le risque sans cesse reconduit d’une limitation de cette liberté produite par l’acte de gouverner.
Cette approche nous permet de replacer le mode d’action de l’Etat dans une pratique bien plus générale et diffuse du pouvoir. Le pouvoir est en effet défini comme un mode d’action sur les autres, mais une action sur une action, une action qui guide et oriente l’action de l’autre. Entre la société civile et l’Etat ne retrouve-t-on pas la même dialectique de la liberté : l’Etat encadre les libertés civiles, les libertés individuelles, il leur permet d’exister comme telles, mais par le même mouvement, il est aussi ce qui les limite et les menace. C’est finalement le moteur du gouvernement qu’une telle opposition entre Etat et Société civile, entre surtout le Pouvoir et la Liberté. La liberté produit du pouvoir et consomme ce pouvoir, de même, le pouvoir fonctionne à la liberté, il la produit et la consomme.
Il faut donc admettre, si l’on adopte ce point de vue, que la liberté existe dans un rapport à l’exercice du pouvoir… De même, l’Etat et le Pouvoir ne sont pas les absolus ou les institutions immuables ou parfaites et abouties de la Raison dans l’Histoire. L’Etat ne serait ainsi pas seulement une « idée fixe », si l’on reprend l’image de Stirner, mais une production historique dont la réalité effective est dans un rapport avec la société civile. On ne peut concevoir l’Etat moderne sans concevoir par le même mouvement la Société civile. Il ne s’agit plus d’un Etat souverain, mais d’un Etat gouvernement, bien plus attaché à une pratique de pilotage des populations et des vies, que simplement à un territoire…
CONCLUSION
Alors que l’approche contractualiste nous présentait un Etat dont l’origine négociée permettait de contraindre ou restreindre légitimement les libertés, nous avons vu que cette légitimité pouvait être remise en cause. En effet, si l’Etat contraint les libertés, n’est-ce pas d’abord pour assurer la domination économique des classes favorisées. C’est le sens de la critique marxiste de l’Etat. L’Etat serait alors une institution au service de la domination de l’homme par l’homme, une médiation dissimulant la réalité des rapports sociaux et empêchant l’individu d’exprimer pleinement sa liberté et ses potentialités créatrices…
Pourtant, cette définition, si elle propose une critique pertinente de la finalité émancipatrice de l’Etat, ne permet pas de comprendre comment la société civile peut se plier à l’autorité de cet appareil politique. Si l’Etat est simplement répressif, s’il n’agit qu’en réprimant les libertés, alors quel est le sens de l’obéissance aux Lois et au Droit qui caractérise nos sociétés ? Pour saisir au mieux les conditions de fonctionnement de nos sociétés, il faut appréhender l’Etat non plus comme simplement une limitation ou au contraire une maximisation des libertés, mais bien comme un gouvernement de ces libertés.
L’Etat s’appuie sur les libertés, il les met en forme et leur offre un espace d’expression. Il y a donc une dialectique entre la société civile et l’Etat, entre les libertés individuelles et le gouvernement…
Ajouter un commentaire