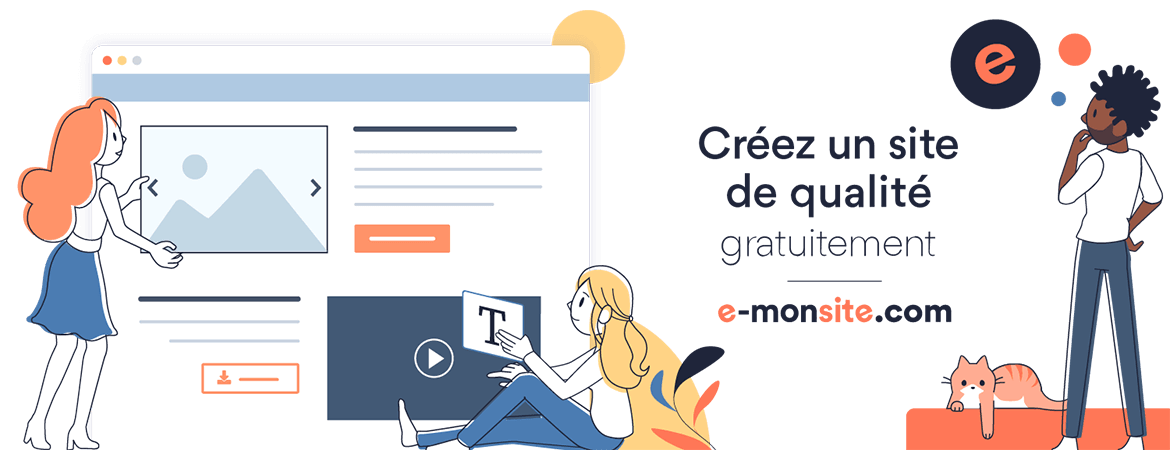- Accueil
- Blog
Blog
B. Pascal - Faiblesse de la raison
![]() Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Par
sgarniel
Le 16/06/2020
« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur, c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c’est en vain que le raisonnement, qui n’y a point de part, essaie de les combattre. Les pyrrhoniens, qui n’ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point, quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison ; cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l’incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu’il y a espace, temps, mouvement, nombres, est aussi ferme qu’aucune de celles que nos raisonnements nous donnent et c’est sur ces connaissances du cœur et de l’instinct qu’il faut que la raison s’appuie et qu’elle y fonde tout son discours.
[...]
La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu’ils voient. Elle est au-dessus, et non pas contre.
Si on soumet tout à la raison, notre religion n’aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule.
La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à reconnaître cela.
Que les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturelles.
Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison.
Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. »
Blaise Pascal, Pensées (1670)
Averroès - Y a-t-il contradiction entre la vérité révélée et la vérité de raison ?
![]() Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Par
sgarniel
Le 16/06/2020
« 18. [Il n'y a pas de contradiction entre la raison et le Texte révélé]
Puisque donc cette Révélation est la vérité, et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, Musulmans, savons de science certaine que l'examen des étants [les choses qui sont] par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le Texte révélé : car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur.
19. En cas de contradiction, interpréter le sens obvie [le sens littéral]
S'il en est ainsi, et que l'examen démonstratif aboutit à une connaissance quelconque à propos d'un étant quel qu'il soit, alors de deux choses l'une : soit sur cet étant le Texte révélé se tait, soit il énonce une connaissance à son sujet. Dans le premier cas, il n'y a même pas lieu à contradiction, et le cas équivaut à celui des statuts légaux non édictés par le Texte, mais que le juriste déduit par syllogisme juridique. Dans le second, de deux choses l'une : soit le sens obvie de l'énoncé est en accord avec le résultat de la démonstration, soit il le contredit. S'il y a accord, il n'y a rien à en dire ; s'il y a contradiction, alors il faut interpréter le sens obvie. »
Ibn Rushd, dit Averroès, Discours décisifs (1179)
S. Freud - Les croyances sont des illusions
![]() Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Par
sgarniel
Le 16/06/2020
« Ces idées, qui professent d’être des dogmes, ne sont pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà : l’impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d’être protégé – protégé en étant aimé – besoin auquel le père a satisfait ; la reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l’homme s’est cramponné à un père, à un père cette fois plus puissant.
L’angoisse humaine en face des dangers de la vie s’apaise à la pensée du règne bienveillant de la Providence divine, l’institution d’un ordre moral de l’univers assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la prolongation de l’existence terrestre par une vie future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes : la genèse de l’univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s’élaborent suivant les prémisses du système religieux. Et c’est un formidable allègement pour l’âme individuelle que de voir les conflits de l’enfance émanés du complexe paternel – conflits jamais entièrement résolus -, lui être pour ainsi dire enlevés et recevoir une solution acceptée de tous. »
Sigmund Freud, L’Avenir d’une Illusion (1927)
L. Boltanski - La construction sociale de la réalité
![]() Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Luc Boltanski - La construction sociale de la réalité
Intervention du sociologue Luc Boltanski dans l'émission "28 minutes", diffusée sur ARTE le 7 mars 2012
K. Marx - La fabrique de l'idéologie
![]() Par
sgarniel
Le 16/06/2020
Par
sgarniel
Le 16/06/2020
«Admettons que, dans la manière de concevoir la marche de l’histoire, on détache les idées de la classe dominante de cette classe dominante elle-même et qu’on en fasse une entité. Mettons qu’on s’en tienne au fait que telles ou telles idées ont dominé à telle époque, sans s’inquiéter des conditions de la production ni des producteurs de ces idées, en faisant donc abstraction des individus et des circonstances mondiales qui sont à la base de ces idées. On pourra alors dire, par exemple, qu’au temps où l’aristocratie régnait, c’était le règne des concepts d’honneur, de fidélité, etc., et qu’au temps où régnait la bourgeoisie, c’était le règne des concepts de liberté, d’égalité, etc. Ces « concepts dominants » auront une forme d’autant plus générale et généralisée que la classe dominante est davantage contrainte à présenter ses intérêts comme étant l’intérêt de tous les membres de la société. En moyenne, la classe dominante elle même se représente que ce sont ses concepts qui règnent et ne les distingue des idées dominantes des époques antérieures qu’en les présentant comme des vérités éternelles. C’est ce que s’imagine la classe dominante elle-même dans son ensemble. Cette conception de l’histoire commune à tous les historiens, tout spécialement depuis le 18e siècle, se heurtera nécessairement à ce phénomène que les pensées régnantes seront de plus en plus abstraites, c’est-à-dire qu’elles affectent de plus en plus la forme de l’universalité. En effet, chaque nouvelle classe qui prend la place de celle qui dominait avant elle est obligée, ne fût-ce que pour parvenir à ses fins, de représenter son intérêt comme l’intérêt commun de tous les membres de la société ou, pour exprimer les choses sur le plan des idées : cette classe est obligée de donner à ses pensées la forme de l’universalité, de les représenter comme étant les seules raisonnables, les seules universellement valables. […]
Toute l’illusion qui consiste à croire que la domination d’une classe déterminée est uniquement la domination de certaines idées, cesse naturellement d’elle-même, dès que la domination de quelque classe que ce soit cesse d’être la forme du régime social, c’est-à-dire qu’il n’est plus nécessaire de représenter un intérêt particulier comme étant l’intérêt général ou de représenter « l’universel » comme dominant.
Karl Marx & Friedrich Engels, L’idéologie allemande (1846)
Lucrèce - Les sens sont-ils trompeurs ?
![]() Par
sgarniel
Le 15/06/2020
Par
sgarniel
Le 15/06/2020
« Tu verras que les sens sont les premiers à nous avoir donné la notion du vrai et qu'ils ne peuvent être convaincus d'erreur. Car le plus haut degré de confiance doit aller à ce qui a le pouvoir de faire triompher le vrai du faux. Or quel témoignage a plus de valeur que celui des sens ? Dira-t-on que s'ils nous trompent, c'est la raison qui aura mission de les contredire, elle qui est sortie d'eux tout entière ? Nous trompent-ils, alors la raison tout entière est mensonge. Dira-t-on que les oreilles peuvent corriger les yeux, et être corrigées elles-mêmes par le toucher ? et le toucher, sera-t-il sous le contrôle du goût ? Est-ce l'odorat qui confondra les autres sens ? Est-ce la vue ? Rien de tout cela selon moi, car chaque sens a son pouvoir propre et ses fonctions à part. Que la mollesse ou la dureté, le froid ou le chaud intéressent un sens spécial, ainsi que les couleurs et les qualités relatives aux couleurs ; qu'à des sens spéciaux correspondent aussi les saveurs, les odeurs et les sons : voilà qui est nécessaire. Par conséquent les sens n'ont pas le moyen de se contrôler mutuellement. Ils ne peuvent davantage se corriger eux-mêmes, puisqu'ils réclameront toujours le même degré de confiance. J'en conclus que leurs témoignages en tout temps sont vrais. »
Lucrèce, De la Nature des Choses (Ier siècle av. J.-C.)
Descartes - Quelle certitude résiste au Doute ?
![]() Par
sgarniel
Le 15/06/2020
Par
sgarniel
Le 15/06/2020
« Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler.
J'avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; mais, parce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, qui fût entièrement indubitable.
Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Et pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir, autant qu'aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit, n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes.
Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. »
Descartes, Discours de la méthode (1637)
Aristote - L'âme et les êtres animés
![]() Par
sgarniel
Le 23/04/2020
Par
sgarniel
Le 23/04/2020
"Pour le moment, bornons-nous à dire que l'âme est le principe des facultés suivantes, et se trouve définie par elles : la nutrition, la sensibilité, la pensée et le mouvement. Chacune de ces facultés est-elle l'âme, ou seulement une partie de l'âme? Et si c'est une partie, est-ce de façon qu'elle soit séparée seulement pour la raison, ou bien aussi séparée matériellement? Ce sont là des questions dont quelques unes peuvent aisément se résoudre, et dont quelques autres présentent de grandes difficultés.
Ainsi, de même que, dans les plantes, quelques unes, comme on peut le voir, vivent après qu'on les a divisées et séparées les unes des autres, comme si pour ces êtres l'âme était parfaitement et réellement une dans chacune d'elles, et qu'en puissance elle fût multiple ; de même nous voyons, avec une autre différence de l'âme, un phénomène analogue se produire pour les insectes que l'on coupe. Chacune de leurs parties possède la sensibilité et la locomotion ; et si elles ont la sensibilité, elles ont aussi et l'imagination et le désir ; car là où il y a sensation, là aussi il y a peine et plaisir ; et là où sont ces deux affections, il y a nécessairement désir.
On ne saurait ici encore affirmer rien de fort clair, ni de l'intelligence ni de la faculté de percevoir ; mais l'intelligence semble être un autre genre d'âme, et le seul qui puisse être isolé du reste, comme l'éternel s'isole du périssable. Quant aux autres parties de l'âme, les faits prouvent bien qu'elles ne sont pas séparables, ainsi qu'on le soutient quelquefois. Mais au point de vue de la raison, elles sont différentes évidemment; car c'est tout autre chose d'être sensible et d'être pensant, parce que sentir et juger sont choses très différentes. Et de même pour chacune des facultés qu'on vient de nommer. De plus, certains animaux les ont toutes, d'autres n'en ont que quelques unes, d'autres n'en ont qu'une seule. C'est là ce qui constitue leur différence ; et nous verrons plus tard quelle en est la cause. Mais il se passe quelque chose d'à peu près pareil pour les sens. Certains animaux les ont tous ; d'autres n'en ont que quelques uns ; d'autres enfin n'en ont qu'un seul ; et c'est alors le plus nécessaire de tous, le toucher."
Aristote, Le Traité de l'âme (IVe s av. JC)