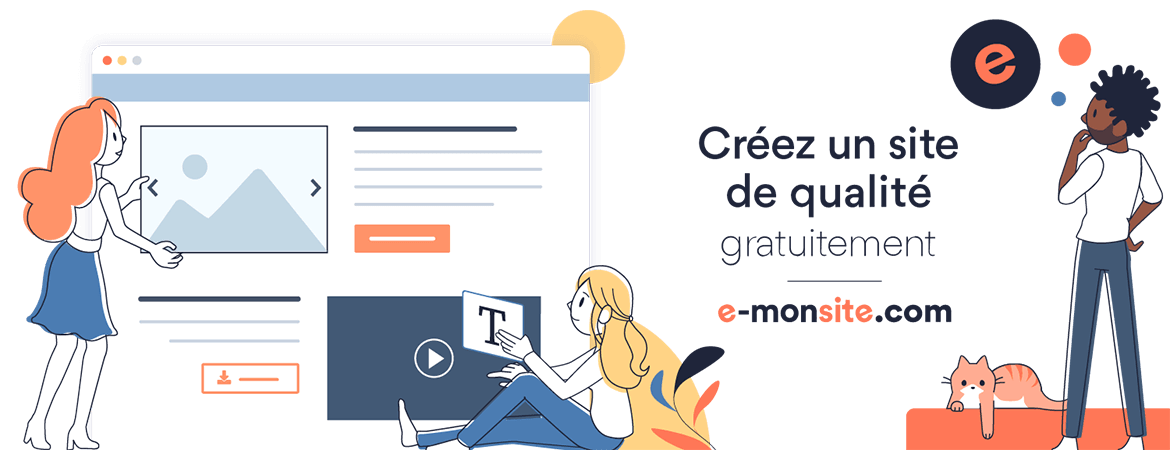« Même la destruction pure des richesses ne correspond pas à ce détachement complet qu’on croirait y trouver. Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’égotisme. […] En effet, et en fait, non seulement on y fait disparaître des choses utiles, de riches aliments consommés avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple, ces cuivres, ces monnaies, que les chefs tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont alliées. Mais le motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces pertes et de ces destructions folles de richesses, n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch , désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit.
Donner, c’est manifester sa supériorité, être plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choir plus bas (minister). Etre le premier, le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et comment on l’atteint. Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux, parents, ce qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang en rendant bracelets contre colliers, hospitalité contre visites, et ainsi de suite… Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’une chose d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes. »
Marcel Mauss, Essai sur le don (1923)