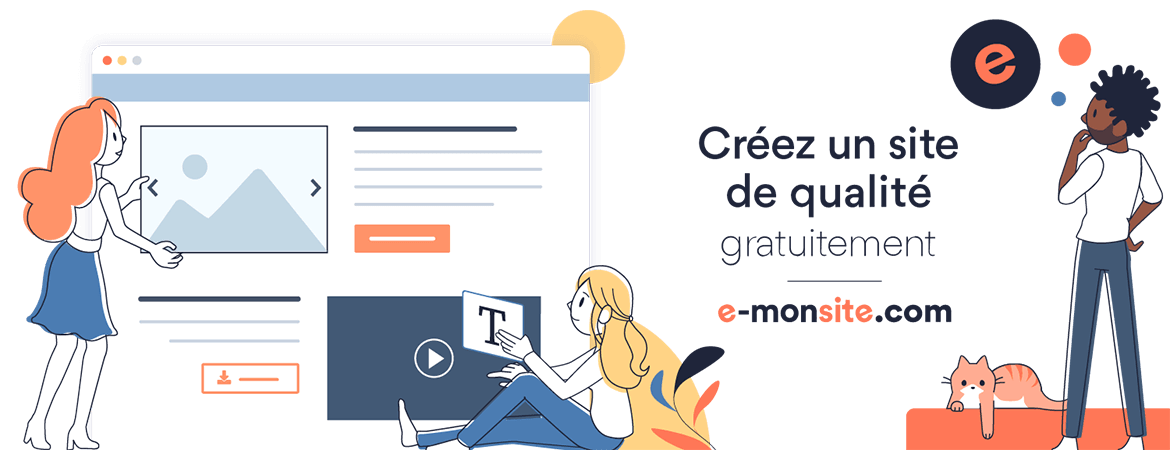Dans son roman Les Caves du Vatican, André Gide met en scène la rencontre fortuite entre deux personnages qui ne se connaissent pas dans le train de Rome à Brindisi. Lafcadio, un jeune homme qui a été éduqué dans la glorification de la liberté. Il s’est fait de cette passion pour la liberté une règle de vie, à tel point qu’il s’inflige un coup de poinçon dans la cuisse dès qu’il pense ne pas avoir agi en toute liberté. Face à lui, Amédée Fleurissoire, un vieux bonhomme qui semble mal à l’aise et qui tente maladroitement de s’installer dans le compartiment sans déranger son voisin. Il gigote, s’agite sur la banquette, avant de se lever pour réajuster son col, puis sa veste, en s’observant dans la vitre de la porte du compartiment. C’est alors qu’une pensée incongrue traverse l’esprit de Lafcadio : et s’il ouvrait soudainement cette porte et faisait basculer le vieil homme hors du train…
Lafcadio se dit qu’il mettrait la police dans l’embarras en commettant un crime sans mobile et surtout qu’il prouverait par-là qu’une action totalement libre est possible. Il s’en remet au hasard en décidant de ne pas passer à l’acte s’il peut compter jusqu’à douze sans voir de feu de signalisation par la fenêtre. Un, deux, trois, quatre, il compte lentement… A dix, un feu apparaît dans la nuit et Fleurissoire est poussé hors du train !
Peut-on vraiment affirmer comme le pense Lafcadio que son acte était gratuit, sans raison et dénué de tout motif ? N’y a-t-il pas au moins une raison qui motive Lafcadio : celle de prouver qu’on peut agir sans raison !